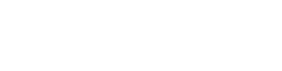|
CAROLE BOUQUET, PASSANTE MAGNIFIQUE
Alexandre Demidoff, Le Temps, 20 mai 2015
La comédienne française incarne une bourgeoise mystérieuse, hantée par la Seconde Guerre mondiale. Elle forme avec Gérard Desarthe un couple subtilement accordé. Récit d’une nuit insomniaque qui clôt en beauté le mandat de Françoise Courvoisier à la tête du Poche
Vous l’espériez désarmante et elle ne vous déçoit pas. Carole Bouquet est là, les genoux ramenés vers le menton, assise sur le canapé d’un salon élégant. Elle est là, depuis un instant, depuis une éternité, vous ne savez pas. Vous la regardez, c’est une passante; c’est une sentinelle; c’est une indifférente. Sur la scène du Poche de Genève, elle incarne Rebecca, cette femme hantée par un homme, son amant, son bourreau peut-être. Face à elle, Gérard Desarthe, son metteur en scène et partenaire dans Ashes to Ashes de Harold Pinter, traduit ici par Dispersion – Mona Thomas signe la traduction du texte pour le spectacle. Il joue le mari, limier obsédé par cet autre qui rôde dans la mémoire de son épouse. Mais écoutez la voix qui débobine la nuit, c’est celle de Nick Cave, il chante «Nobody’s baby now...», l’histoire d’un amour en fuite. La chanson reviendra comme un leitmotiv et une clé de lecture. Gérard Desarthe se détache de la musique et du gris du décor, comme un crooner sonné. D’un coup, la lumière jaillit et Carole Bouquet avec. Elle dit: «Ben… par exemple… il se plantait devant moi le poing fermé. Et là il attrapait mon cou dans son autre main et il serrait en tirant ma tête vers lui.» Elle parle de l’autre, en somnambule. Mais il en veut plus. Alors, elle continue dans un demi-sourire. Plus elle avance, plus elle dévie et moins on distingue les contours de ce compagnon, chevalier servant ou odieux tortionnaire sorti du cauchemar nazi.
Ce que Pinter offre, c’est une perturbation temporelle. La pièce dure une heure à peine, mais vous avez l’impression d’avoir traversé les ruines d’une époque. Chaque séquence est un arrêt sur image. Un paysage cristallisé, arraché au flux, sauvegardé miraculeusement. Il s’incruste et s’efface presque aussitôt. Il en reste la cendre, celle que vous ne disperserez pas, celle que le vent n’ose balayer. L’écriture de Harold Pinter est faite de ça, d’un malaise qui virevolte en particules élémentaires, qui, dans le meilleur des cas, se dépose dans les mémoires, qui laisse au spectateur un butin d’autant plus précieux qu’il est impalpable: l’impression d’avoir accédé à un secret, de l’avoir touché sans l’avoir percé. Car l’intérêt de Dispersion est là. Le trouble persiste jusqu’au bout. Rebecca est peut-être mythomane. Peut-être médium. Peut-être dérangée. Elle ne clôt rien. Elle entrouvre. Pour toucher à ce principe d’incertitude, il faut subir l’emprise de Pinter, puis la desserrer en douce, se fondre dans un silence, jouer sur les nerfs, mais comme anesthésié. C’est ce que font Gérard Desarthe et Carole Bouquet. Voyez comme il lui tourne autour, comme sa main gauche scande l’impatience, comme sa voix caresse et menace, comme les mots se précipitent soudain dans sa bouche. Il prend ses aises sur le canapé. Elle se rétracte en nénuphar. Il voudrait savoir la couleur des yeux de l’autre. Il l’appelle «chérie». Elle se rebiffe: «Mais je ne veux pas être ta chérie. C’est la dernière chose que je voudrais. Je ne suis la chérie de personne.» Et lui: «C’est une chanson.» Elle: «Quoi?» Lui: «I’m nobody’s baby now.» Cet échange est un échantillon. Vous l’écoutez d’une oreille distraite. Il amorce un motif, l’image encore embryonnaire d’un nouveau-né, qui bientôt deviendra obsédante. Carole Bouquet, alias Rebecca, se rappelle à présent ce jour où elle suit l’homme dans une usine, où les ouvriers les accueillent avec révérence; elle revoit le quai d’une gare, des mères qui attendent, un bébé dans leurs bras, et lui qui passe et leur arrache les enfants. Mais voici qu’elle se dresse devant vous. Derrière, la scène est une page noire sur laquelle tombent en lettres insomniaques les mots d’un aveu impossible. Elle porte son bébé, c’est ce qu’elle prétend, l’homme le lui prend. Elle en est à jamais orpheline. Carole Bouquet joue Pinter à fleur d’eau. Elle en révèle la surface, elle en pointe le bas-fond, elle en fait remonter la vase en petits tourbillons. Gérard Desarthe, lui, est cet inquiet que la dérobade d’une femme désarticule, cet homme sans qualité qui perd pied sous nos yeux. Il cherche à pénétrer une tour de cristal, cette inconnue qui l’éclabousse de sa clarté et qui s’absente à vue. Ce qu’on appelle présence au théâtre peut se définir ainsi: une façon d’être ailleurs aux yeux de tous.
Harold Pinter a la soixantaine quand il écrit Ashes to Ashes. Il n’a pas encore reçu le Prix Nobel de littérature – c’est pour 2005 –, pas encore déclaré la guerre à Tony Blair, à George Bush. Il n’a pas beaucoup écrit sur la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, sur l’antisémitisme qu’il a subi, enfant, à Londres même, sur ces bandes odieuses qui défilaient en chemises brunes aux ordres de leur leader Oswald Mosley. Il a feint d’oublier. S’il revient à ces années, c’est qu’elles ne sont pas vraiment passées, qu’elles se confondent avec le smog. Rebecca est faite de cette brume. Dans sa Conférence du Nobel (Gallimard), il parle du langage ainsi: «Donc le langage en art reste une opération extrêmement ambiguë, un sable mouvant, un trampoline, un étang gelé qui pourrait bien céder à tout moment sous votre poids, à vous l’auteur.» Gérard Desarthe et Carole Bouquet possèdent cette délicatesse: ils font craqueler l’étang, comme en passant. Toute autre option ne serait pas pintérienne. CAROLE BOUQUET DANS LE MIROIR DE PINTER Alexandre Demidoff, Le Temps Sortir, juin 2015
Les pièces du Britannique Harold Pinter (1930-2008) sont des miroirs. Elles vous renvoient à vous-même à travers leurs buées. Prenez Ashes to Ashes, l’un de ses derniers textes. Face à face, un homme, une femme. Elle, c’est Carole Bouquet, lui, Gérard Desarthe. La première subjugue à l’écran depuis au moins Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Le second ravit au théâtre, splendide notamment dans le rôle de Hamlet en 1988 dans la Cour d’honneur du Palais des Papes au Festival d’Avignon – un spectacle signé Patrice Chéreau. Si ces deux comédiens s’aimantent, c’est que Gérard Desarthe, qui signe la mise en scène, l’a voulu ainsi : monter Ashes to Ashes qu’il a traduit par Dispersion était inconcevable sans Carole Bouquet. « C’est à mes yeux l’actrice la plus énigmatique du cinéma et du théâtre français, confie-t-il. Elle pourrait se satisfaire de choses beaucoup plus simples, elle a accepté une pièce et un rôle difficiles. »
Une affaire de couple, dites-vous ? Oui, mais à la manière de Pinter, dangereuse, donc. En ouverture, Rebecca – le prénom de la femme, jamais prononcé – dit : « Eh bien… par exemple… il se plantait devant moi et il fermait le poing. Et puis il plaquait son autre main sur ma nuque, il serrait… et il attirait ma tête vers lui. Il frottait son poing sur ma bouche. Et il disait : « Embrasse mon poing. » De qui parle-t-elle ? De son amant ? C’est ce que croit Devlin, son mari. Il interroge, méthodique. Il voudrait savoir ce qui s’est passé exactement ; comment était l’autre ; qui était-il surtout ? Elle répond, en état second. Elle raconte par exemple un après-midi lointain au bord de la mer ; dans une clarté magnifique, des gens apparaissent en cortège, ils portent des bagages, s’avancent vers l’eau, qui, stupeur, les submerge. Elle se revoit encore sur un quai de gare ; tout près d’elle, il y a son meilleur ami, l’homme à qui elle a donné son cœur, ce sont ses mots. Mais il passe auprès de femmes massées au bord de la voie et leur arrache leurs bébés. Tout cela s’imprime en fine buée, particules glacées d’un paysage cauchemardesque. A la lecture, le texte pénètre comme par fragmentation. Il vous aspire, puis résiste. Ce pouvoir, Gérard Desarthe l’explique ainsi. « Souvent, on monte Pinter comme un auteur de boulevard brillant, dit-il. Or c’est un écrivain labyrinthique. Ashes to Ashes est son avant-dernière pièce, il la monte d’abord à Londres en 1996 puis à Paris en 1998. Il y parle de nous, de la violence que les femmes subissent, mais aussi de lui, d’une vie hantée par l’horreur nazie, par l’écho des camps, par l’antisémitisme qu’il a subi. Ces sujets, il ne les aborde pas dans une grande partie de son œuvre, sauf vers la fin. »
Harold Pinter est un auteur à multiples détours. Il écrit aussi bien sur les fraternités tordues (Le Gardien) que sur des couples vernis qui s’écaillent sous nos yeux (Trahisons). Il est l’écrivain qui doute par excellence : des mots et de leurs usages, des idéologies et de leurs ravages, des loyautés proclamées. Mais il a des principes auxquels il ne déroge pas. Il dénonce en 2005 l’intervention occidentale en Irak ; pourfend Tony Blair ; s’indigne de voir flétrie la bannière de la liberté, compromise dans de sales causes. Est-ce parce qu’il a toujours dans l’oreille le sifflement des bombes sur Londres pendant la guerre ? Ou parce qu’il n’oublie pas la violence des chemises noires de l’Union fasciste d’Oswald Mosley, leur antisémitisme dont il est la victime ? Le Prix Nobel de littérature est en colère, c’est-à-dire aux aguets, ce qui ne l’empêche pas d’être un gentleman accompli, époux en seconde noce de Lady Antonia Frazer. Comme chez Samuel Beckett que Pinter vénère, comme chez Marguerite Duras, le dialogue est troué par des silences. « Il faut tous les traiter, poursuit Gérard Desarthe, et distinguer leur intensité. Un silence n’a pas la même valeur qu’une pause. Souvent, les acteurs n’osent pas tenir un silence, parce qu’ils ont peur d’ennuyer. Un silence, c’est aussi une image pour le spectateur. »
Si Dispersion obsède, c’est que l’écriture de Pinter procède par prélèvement. Une fraction d’histoire entre en friction avec une autre. A un moment, Devlin dit à Rebecca : « Je passe l’éponge. Tu remarques. Je laisse glisser. Mais c’est peut-être moi qui suis en train de glisser. C’est dangereux. Tu remarques ? Je suis dans les sables mouvants. » Gérard Desarthe : « Devlin ne peut pas comprendre. Il ne peut pas entrer dans le fantasme de cette femme. Elle est hantée par les morts, par l’histoire. » Dispersion – comme disperser des cendres – oblige l’acteur à revenir à l’essence du métier : ouvrir le texte comme on ouvre une boîte, en réveiller l’écho. Ne rien obturer surtout. De cette écriture, Gérard Desarthe dit qu’elle est talmudique. Harold Pinter, lui, éclairait ainsi sa pièce: « Dans Ashes to Ashes, je ne parle pas seulement des nazis ; je parle de nous, de notre propre conception de notre passé et de notre histoire et de ce que cela peut avoir comme répercussion sur notre présent. » DISPERSION DE HAROLD PINTER Francis Richard, www.contrepoints.org, 28 mai 2015
Hier soir, c'était la première de Dispersion (Ashes to Ashes) de Harold Pinter au Poche de Genève, la dernière première sous la direction de Françoise Courvoisier. Sans se départir de son ineffable sourire, une fois cette pièce terminée, ce fut pour elle le commencement d'une fin en beauté. Françoise Courvoisier a en effet offert aux spectateurs du soir et offre à ceux des soirs suivants le somptueux cadeau d'une pièce exigeante, complexe, écrite dans une langue simple et épurée pourtant, incarnée par des comédiens d'exception, vivant intensément ce qu'ils disent. Dans sa traduction française de Mona Thomas et sa mise en scène de Gérard Desarthe, Dispersion a été jouée auparavant au Théâtre de l'Oeuvre, à Paris, du 16 septembre 2014 au 14 novembre 2014, au Théâtre des Célestins, à Lyon, du 12 au 24 mai 2015. Peut-être, après Genève, y aura-t-il l'an prochain une tournée dans les provinces françaises...
Pendant la représentation de ce texte tout en nuances, l'attention du public d'hier soir est palpable. Il est avide de ne pas perdre un mot de ce long poème en prose, qui parle tout autant au coeur qu'à l'esprit. Cette attention, qui est tension par moments, lui permet de ne pas laisser passer les quelques occasions de rire aux traits d'humour, anglais, of course, de l'auteur. L'humour n'est-il pas l'un des moyens les plus sûrs, dans l'existence, de supporter quelque peu l'insupportable? La pièce commence par une chanson de Nick Cave, Nobody's Baby Now. Dont les paroles sont prémonitoires de ce qui va se jouer pendant une heure. Le décor, sobre, est celui d'une pièce de séjour, meublée d'un fauteuil, d'une table basse et d'un canapé, de deux lampes en forme de bulbes. Deux bouteilles de whisky, qui sont entamées, deux verres sur la table basse, qui ont déjà servi, le complètent. Tout au long de la pièce des lumières modifient l'ambiance de ce décor et indiquent les moments de la journée. Devlin (Gérard Desarthe) se sert un verre et le tient dans sa main. Rebecca (Carole Bouquet) est assise sur le canapé et ses mains tortillent nerveusement un foulard soyeux. Rebecca parle en premier et fait l'aveu, à mots comptés, de l'existence d'un amant dont rapidement le spectateur qui se trouve à distance des deux protagonistes sait qu'il est inventé, tandis que Devlin tente en vain d'en savoir davantage sur lui. Rebecca dit peu de choses de cet amant et ses réponses ne satisfont pas Devlin. Et pour cause. Mais le peu qu'elle lui dit est inquiétant. Car cet amant mystérieux ne peut lui apparaître que tendre et brutal à la fois. Devlin est quelqu'un qui a un fort sens commun, qui pose des questions précises et qui attend des réponses tout aussi précises. Quand Rebecca lui dit qu'elle a fait tomber par terre un stylo innocent, il se récrie. Elle ne peut pas dire des choses pareilles, puisqu'elle ne sait rien de ce stylo et ne connaît pas ses parents... Rebecca est ailleurs, dans un autre monde, un monde parallèle, qu'elle s'est créée à partir d'images qui la hantent. Ces images la hantent alors que rien ne lui est jamais arrivé à elle, ni à ses amis, et qu'elle n'a pas souffert. Son prétendu amant est une sorte de tour operator, qui l'a emmenée dans une sorte d'usine, semblable aux autres usines, mais où les ouvriers portent des casquettes et suivraient ce guide "tout en haut de la falaise et jusqu'au fond de la mer s'il le leur demandait". Indices après indices le monde fantasmé par Rebecca prend des contours plus précis comme s'il émergeait d'un brouillard, sans pourtant faire émerger Devlin de sa nuit. Ainsi l'usine n'a-t-elle pas de toilettes, comme à Auschwitz... Ainsi Rebecca raconte-t-elle que son guide "allait à la gare et en marchant le long du quai il arrachait tous les bébés des bras de leurs mères qui hurlaient". Des mondes parallèles ne peuvent se rencontrer et, quand Devlin essaie à la fin de répéter un geste de l'amant de Rebecca qu'elle lui a décrit, geste qui semble l'avoir émue, il montre à quel point il ne peut la comprendre, leurs mondes étant décidément complètement hermétiques l'un à l'autre. Rebecca elle-même finit par dénier ce monde que son esprit a créé..Les expressions, les mots et les noms employés par Harold Pinter ne sont pas fortuits.
Ashes to Ashes vient de ce verset de la Genèse où le Créateur dit à un Adam coupable: "C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras."
Guide se traduit en allemand par Führer...
Rebecca, femme d'Isaac, devait donner naissance à deux jumeaux, Esaü et Jacob, qui, en son sein, s'étaient battus...
Il y a donc des références talmudiques et datées dans ce texte, mais cela ne restreint pas pour autant sa portée universelle. Il est, comme dit plus haut, un long poème en prose, à deux voix, où l'inhumanité de l'homme pour l'homme, la barbarie dont il peut se rendre coupable, peuvent hanter ceux qui n'en ont pourtant pas subi directement les effets atroces. Carole Bouquet est l'incarnation même de ceux, ou de celles, qui sont ainsi tourmentés et qui imaginent très bien les atrocités commises ici ou là. Les cheveux noués en chignon dégagent sa nuque et lui font un port altier. Sa voix, par moment sépulchrale, qu'un écho renforce alors, l'éloigne du commun des mortels. Elle n'est pas folle, elle souffre. Et, de temps en temps, elle sourit d'un sourire qui illumine sa beauté hiératique. Gérard Desarthe est l'incarnation même de ceux qui sont sans imagination. Quand Rebecca ose suggérer que Dieu puisse s'enfoncer dans les sables mouvants, il ne voit qu'une chose, les dieux du stade qui déserteraient les gradins lors d'une finale Angleterre-Brésil à Wembley (où Dieu était-il?). Il est un homme ordinaire, à la voix familière, au corps rond, accomplissant des gestes de tous les jours, comme celui de se verser à boire ou de déposer un baiser sur le front de Rebecca.
Une fois la pièce terminée, la salle vide de spectateurs sur laquelle je jette un coup d'oeil par la porte qui donne dans la rue du Cheval Blanc, je me retourne et aperçois Carole Bouquet qui s'éloigne dans cette rue, cheveux dénoués, longs et raides dans la petite brise du soir. Elle est rayonnante d'une beauté bien vivante, qu'elle dissimule en vain derrière des lunettes... Elle est retournée dans la vraie vie, tandis que je reste étourdi par les émotions qui m'ont assailli... ET SI DES CENDRES PEUT RENAÎTRE UNE LUMIÈRE ? Oscar Ferreira, L'Agenda, 1er juin 2015
C’est dans un décor épuré et sobre que le duo de comédiens fait son entrée sur scène, dans l’intimité de ce théâtre qui se prête décidément si bien à la naissance d’une communion avec le public. Deux canapés à la blancheur clinique font face à une bouteille de whisky, entamée sur le comptoir. Les protagonistes se livrent à un périlleux dialogue, entre discussion franche et interrogatoire. Mais le jeu des apparences va réveiller des profondeurs de la mémoire des récits tragiques. Au départ la conversation semble plutôt banale, le mari touché dans son amour-propre pose toute une série de questions à son épouse adultère. Qui est cet amant ? Quelle est son identité ? Et l’intimité avec lui, que lui a-t-elle apportée de plus ? Delvin tente ainsi de tracer un cadre dans les retors contours de l’esprit de Rebecca, cette dernière n’étant toutefois pas disposée à répondre de manière précise. De ce dialogue désaccordé, Rebecca va se lancer dans une série de digressions troublantes. La réalité se confond ainsi avec l’imaginaire, laissant apparaître les tourments et les troubles d’une époque tragique à travers la pensée de cette femme. Toute la subtilité de la pièce est ainsi magnifiquement incarnée, laissant au spectateur la libre interprétation de ce qui relève de la réalité ou du fantasme. « J’avais une quinzaine d’années à la fin de la guerre ; Je pouvais écouter, entendre et tirer mes conclusions, aussi ces images d’horreur, cette illustration de l’inhumanité de l’Homme envers l’Homme ont elles laissé une impression très forte dans mon esprit de jeune homme. En réalité, elles m’ont accompagné toute ma vie. » Harold Pinter En écrivant cette pièce, Harold Pinter n’a pas pris comme point de départ l’Allemagne nazie. Il a fait le choix de documenter en quelques sortes l’horreur, l’inimaginable. Comment parler de la Shoah ? Comment faire pour transmettre cette mémoire ? L’auteur, Prix Nobel de littérature en 2005, a ainsi pris le parti de l’expiation collective à travers les images. Rebecca est hantée par cette mémoire qu’elle transmet au spectateur. En nous racontant ce récit, elle nous fait voyager dans l’abîme et au fond peu importe de savoir dénouer le fil de ce qu’elle imagine ou de ce qu’elle a réellement vécu. Point d’évidences ici ni de routes toutes tracées, voilà ce qui constitue le corps et la force de cette œuvre. Une expérience du théâtre qui ouvre des perspectives et qui laisse toute sa place à la démarche introspective. La mise en scène, élégante et soignée, est un bel écrin pour le jeu des deux comédiens. Carole Bouquet, resplendissante, offre un personnage tout en finesse à la pudeur délicate. Difficile de ne pas être interpellé par l’élégance toute naturelle dans la posture de cette comédienne, toujours impeccablement droite et posée. Elle passe ainsi de la rigidité mentale, qui empêche le corps de s’exprimer tout en torturant sa couverture en cachemire, à la subtile expression des souvenirs douloureux d’une époque. Le refus de l’intimité avec ce mari qu’elle n’aime plus par le verrouillage complet des sentiments peut alors voler en éclat, pour le plus grand plaisir de tout amateur de grand théâtre. CAROLE BOUQUET CLÔT EN BEAUTÉ LE RÈGNE DE FRANÇOISE COURVOISIER Jean-Jacques Roth, Le Matin Dimanche, 24 mai 2015
Ce sont les beaux adieux de Françoise Courvoisier au public du Théâtre de Poche qu’elle a dirigé pendant douze ans. Après une série de spectacles assurés par les complices qui ont accompagné son règne, voici les derniers feux. La « Bouquet finale ». Car la grande comédienne, devenue rare au cinéma où plus grand-chose ne la tente, joue « Dispersion », une des dernières pièces de Harold Pinter. C’est Gérard Desarthe qui la lui a proposée. Comédien mythique, lui aussi ! Carole Bouquet se souvient de lui comme d’un modèle lorsqu’elle apprenait son métier. Dans « Dispersion », il est celui qui fait parler la femme dont le discours, peu à peu, se peuple de souvenirs qu’elle n’a pas vécus, évoquant les camps, la déportation, la Shoah… « Il me semble qu’on vit tous dans une pièce de Pinter, avec la difficulté de communiquer », a-t-elle dit de cette pièce qui a triomphé à paris l’automne dernier. Carole Bouquet n’a aucune peine à habiter les longs silences de ce texte aux confins de l’abstraction : son talent est précisément fait d’une forme de distance pénétrée de mystère. Carole Bouquet a eu plusieurs bonnes fortunes dans sa carrière. La première est d’avoir été choisie par Luis Buñel à l’âge de 18 ans, alors qu’elle était en deuxième année de Conservatoire, pour tourner « Cet obscur objet du désir ». La seconde est d’avoir joué dans un James Bond, « Rien que pour vos yeux », en 2001 – « Quel ennui ! » dit-elle de ce tournage qui lui a néanmoins assuré une gloire internationale. Puis elle a été pendant quinze ans l’égérie du Numéro 5 de Chanel, ce qui lui a donné « une liberté artistique totale ». Elle en a fait bon usage, choisissant les films qu’elle voulait, risquant son image inaccessible par des contre-emplois et des comédies. Elle s’est aussi engagée en faveur de l’enfance meurtrie, possède à Pantelleria, au large de la Sicile, une propriété vinicole patiemment constituée, aussi célèbre que sa relation de dix ans avec Gérard Depardieu, qui a pris fin en 2005. Elle peut revenir à ses premières amours théâtrales le cœur léger, fût-ce pour un texte grave qu’elle porte avec sa classe légendaire. C’est avec Pinter, déjà, qu’elle avait débuté sur les planches. La pièce s’intitulait « C’était hier »… LA PRESSE EN PARLE
Gérard Desarthe livre de Dispersion une mise en scène d'une sobriété et d'une justesse musicale exemplaires : un écrin pur et abstrait pour une Carole Bouquet magnifique, d'une beauté et d'un mystère à couper le souffle.
Le Monde
Desarthe, metteur en scène, fait résonner très justement cette pièce terrible qui se suffit d'une heure à peine pour nous glacer et nous ébranler. […] Carole Bouquet, qu'on n'avait pas vue sur scène depuis quatre ans, est bouleversante dans ce rôle de femme banale rattrapée, comme à son insu, par le martyre de l'humanité.
Le Nouvel Observateur
Carole Bouquet, dirigée au cordeau par Gérard Desarthe, qui est aussi son partenaire, rencontre là un de ses plus beaux rôles. Un rôle en creux, habité par la beauté de son phrasé et de son timbre, par la lumière de son visage, comme lavé à grande eau. Très en retrait dans le jeu, Desarthe l’a amenée, presque amoureusement, à la perfection.
L‘Express
Les deux comédiens se révèlent remarquables. Précis, denses, ils jouent la carte du dépouillement, de la rigueur, de l’intensité. […] Austère sans jamais être poseuse, cette représentation nous emporte presque instantanément dans la profondeur et l’étrangeté de l’écriture de Harold Pinter. Car cette écriture naît, résonne, s’ouvre, dévoilant les béances d’un monde habité par des mystères et des fantômes.
La Terrasse
Le travail fin, profond, rigoureux de Desarthe, trop rare sur les scènes ces dernières années, en révèle l’essence même, les ombres et les lumières. Inquisiteur obstiné, précis, à la violence rentrée, il forme avec sa partenaire un couple pénétrant. Le jeu intérieur de Carole Bouquet, habitée de mémoire, imprégnée de souffrance, interpelle et cueille le spectateur. C’est l’art de l’exigence.
Le JDD
Une heure, une petite heure grave et fascinante, avec deux comédiens de haut talent qui donnent la juste musique de la brève pièce, ici traduite par Mona Thomas. Desarthe et Bouquet, un grand moment de théâtre délicat et subtil. Le Quotidien du médecin |
DISPERSION |