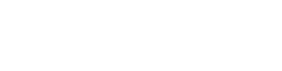|
LE LANGAGE, UN CHEMIN VERS LA LIBERTÉ
Entretien avec Jeanne Benameur
En quoi le langage est-il une épreuve selon vous ? Quand on accepte de parler, on accepte forcément de sortir de la fusion. Dans la fusion on n’a pas besoin de parler : l’autre, on le devine, et de l’autre on imagine qu’il peut tout savoir de nous sans qu’on ait à le dire. Comme une certaine représentation de la mère qui saurait reconnaître aux pleurs du bébé s’il a soif, s’il a faim, s’il est sale… il y aurait cette sorte de communion perpétuelle, cette communion idéale dont peut-être on rêve tous : être compris sans avoir besoin de parler. Je fais la différence entre communion et communication. Rentrer dans le langage, c’est reconnaître que l’on ne me comprend pas, on ne me devine pas, et si je veux vivre avec les autres, tous les autres, il faut que je me fasse entendre, donc il faut que j’arrive à dire mes désirs, mes craintes, que j’arrive à me dire. C’est une épreuve parce qu’il y a toujours quelque part une tentative de retrouver cette communion première, mais en passant par le langage, pour atteindre le moment où l’autre en face, grâce à mes mots, va entrer dans cette communion avec moi. Pour moi c’est cela être humain, c’est être dans le langage, c’est accepter de passer par là, pour pouvoir, à nouveau, être en harmonie avec les autres. Ce serait cela l’épreuve fertile.
Finalement, ce serait d’autant plus une épreuve qu’avec le langage on n’atteint jamais cet objectif. C’est une tentative désespérée, mais jamais désespérante. C’est pareil quand on écrit. Quand j’écris qu’est-ce que je fais d’autre, si ce n’est tenter de retrouver avec un lecteur que je ne connais pas, un partage d’émotions que j’aurai réussi à mettre en forme de telle façon que l’autre puisse y entrer aussi et vivre avec moi hors du temps, hors de l’espace, cette communion-là. C’est un état de grâce qui est recherché, en dehors de toute connotation religieuse.
Les Demeurées, nous a beaucoup accompagnées ; dans votre écriture, il y a de la force, quelque chose de puissant. C’est ça le travail de l’écriture, une tentative désespérée, mais une tentative tenue, une tentative maintenue persévérante à travers le temps. Comment trouver avec la langue, la forme la plus juste pour que l’autre en face, le lecteur, la lectrice, entre dans la vision d’un personnage, qu’il entre dans sa façon d’être au monde. Ma passion dans la vie, est là, dans ce travail d’écriture. Tout le reste est accessoire. Pour cette recherche-là il faut faire feu de tout bois, il y a les mots, le rythme, la syntaxe. J’avais fait lire à J.M. Ozanne, libraire à Montreuil, une première forme des « demeurées ». Il a senti, dans cette première mouture, que quelque chose n’était pas encore abouti. Les mots qu’il a employés, m’ont permis de travailler à la maison et de me rendre compte que j’avais utilisé les mêmes formes syntaxiques pour mes trois personnages et ça ne pouvait pas être ainsi. On ne peut pas parler de la Varienne comme on parle de Mlle Solange. Ça n’est pas possible parce que, dans sa tête, le langage ne fonctionne pas de la même façon. La Varienne n’est que dans des phrases simples, un seul verbe. Des verbes et donc des actions juxtaposées, car elle est complètement dans une chose, elle ne voit pas à côté et puis elle va être complètement dans une autre. Alors que Mlle Solange établit tous les liens de cause, d’effet, de temps, de conséquence, tout ce qu’on appelle les circonstances, la grammaire. C’est tout bête, elle est dans la phrase complexe. On peut mettre une principale, des subordonnées… Or moi j’avais fait cela avec tous les personnages. La petite Luce ne pouvait être que sur des formes impersonnelles. « Il faut… », « il ne faut pas… » Elle est dans l’impératif jusqu’à ce qu’elle puisse entrer dans le langage et sortir de cet impératif. Elle est dans des obligations. Il fallait l’écrire comme cela si on voulait redonner sa façon de sentir le monde. La force du texte est je crois, dans ce travail final qui a redonné à chacun son mode syntaxique. La syntaxe, c’est la façon d’être au monde.
Pour tisser des liens il faut quitter sa mère, l’épreuve du langage c’est l’épreuve de la séparation ? Oui si je me fie à ce que j’ai vécu. Ma mère nous a parlé italien tant que nous ne parlions pas. Entrer dans la langue française c’était une double trahison, c’était entrer dans le langage et dans une langue qui n’était pas la sienne. Ce n’était même pas aller vers la langue de mon père puisque lui était arabe… mais tous les deux avaient fait le choix de la langue française, c’était aussi respecter leur choix. C’est une étrange histoire. Quand j’étais enfant, j’ai vécu très fort l’exil par rapport à mes parents mais aussi par rapport à mes frères et sœurs. Quand on a quitté l’Algérie j’étais petite, 5 ans, je n’allais pas encore à l’école. J’ai fait mon expérience scolaire en arrivant en France, quand ma mère, qui m’avait appris à lire, m’a amenée à l’école, qui était obligatoire. C’était en décembre. J’ai découvert là un lieu qui m’a intéressée, qui m’a passionnée. Alors j’y suis allée avec les yeux et les oreilles grands ouverts. Il est difficile de décrire le plaisir que j’avais à être dans une bibliothèque, c’était extraordinaire d’avoir tous ces livres possibles… En arrivant dans ce monde de l’école, j’ai connu un choc, le « choc des univers » : mes parents, qui étaient très peu allés à l’école, ne connaissaient pas la littérature, ma famille n’était pas une famille de lecteurs. Pour moi c’était un monde fabuleux. Mes frères et sœurs ne se sont pas adaptés à l’école en France. Ils avaient vécu plus longtemps en Algérie et étaient très attachés au mode de vie là-bas. Moi, j’avais une espèce de virginité par rapport à l’école et l’école m’a ouverte au monde des livres, alors qu’eux étaient dans le repli. C’est pour cela que je dis que l’exil était aussi par rapport à eux.
L’entrée dans ce monde était une double forme d’exil ? Oui. Entrer dans les livres cela voulait aussi dire quitter mes parents, ma famille. C’est toujours difficile, cela m’a beaucoup servi en tant qu’enseignante dans ces banlieues où j’ai tellement travaillé. Comprendre ce que ça pouvait être pour un jeune homme, une jeune fille de ne pas pouvoir quitter le clan, le village, la famille, pour entrer dans la littérature et je trouvais que mon rôle c’était de les aider à faire cela, en leur faisant sentir qu’ils n’allaient rien perdre. On ne perd pas, bien au contraire. On peut revenir et enrichir les liens avec les siens. Tout s’est retissé avec mes frères et sœurs à partir de mes livres. Qu’ils soient écrits par quelqu’un de la famille faisait que quelque chose était possible avec cet univers de la littérature ; même si c’était difficile.
Il ne serait pas question de perte ? On ne perd pas ; on coupe le cordon. On perd ce qui nous rattache de façon non voulue et non consciente, et ça, c’est de la bonne perte ! Après on tisse les liens qu’on veut, en étant conscient. Bien sûr il y a toujours notre insu qui est là aussi. Mais quand même, on a une part de conscience plus grande et plus libre quand on est entré dans le langage et dans la littérature. C’est une porte extraordinaire. C’est pour moi le chemin de la liberté. Je n’en connais pas d’autre.
réalisé par Pascale Mignon et Marina Stéphanoff, décembre 2005 |
LES DEMEURÉES |