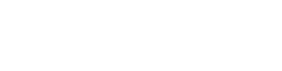|
LÂGE DOR DES NOCEURS
Nicola Demarchi, Le Courrier, 17 septembre 2014
«Fever», d’Attilio Sandro Palese, qui ouvre la saison du Poche, fait rouler les mécaniques des années discos. Mais en mode hiératique.
Pattes d’éléphant moulantes sur semelles compensées, chemises avec col «pelle à tarte» ouvertes sur des poitrines à crucifix, des mains pleines d’anneaux qui tripotent constamment une coiffure au gel ou d’autres apparats de frime... Ce sont les viveurs façon années 70, souvent associés à la communauté italo-américaine, suivant un folklore urbain un brin trompeur, véhiculé par le film culte Saturday Night Fever.
Ambitions et désarrois
Verve jouissive AU POCHE, LA FIÈVRE PREND UN COUP DE FROID Marie-Pierre Genecand, Le Temps, septembre 2014
Attilio Sandro Palese adapte «La Fièvre du samedi soir» au théâtre. Sa proposition, glaçante, raconte le mortel ennui des adolescents d’hier et d’aujourd’hui.
Oubliez le scintillement des paillettes et l’ivresse des pulsations disco. Dans son adaptation théâtrale de La Fièvre du samedi soir au Poche à Genève, Attilio Sandro Palese n’a gardé que la face sombre du film culte de John Badham. Parfois ses six interprètes, jeunes et beaux, esquissent quelques pas de danse, enchaînent avec aisance une série de mouvements stylés. Mais toujours sur le mode fantomatique, neurasthénique. Comme si la fête était déjà finie… Le plus souvent, les Tony, Vincent, Eugène prennent la pose et fixent le public, le visage figé, aux antipodes de Travolta, addition de nervosité et de sensualité dans le film qui a lancé sa notoriété. Le choix de Sandro Palese est en rupture, radical. Il raconte parfaitement le désenchantement de ces secundos italiens qui, à la fin des années 1970, à Brooklyn, ne croyaient pas au rêve américain.
Plus largement, Fever à la vie à la mort dit aussi le désœuvrement adolescent. Ce temps des doutes et du look. Ce qu’on vaut, ce qu’on veut. Ce qu’on est prêt à risquer pour décoller, ce qu’on aimerait préserver. Vertige d’un âge si fragile… Attilio Sandro Palese, metteur en scène punk de la scène romande, a gardé beaucoup de cet âge du tourment. Ses précédentes créations, à la réussite diverse, le prouvent.
Dans Nobody dies in Dreamland, par exemple, un texte de sa composition créé en juin dernier au Grütli à Genève, puis à l’affiche du Théâtre 2.21 à Lausanne, il dénonçait la vulgarité ordinaire en recensant plusieurs abus de pouvoir. D’un homme d’église sur une famille de prolétaires, d’une épouse sur son mari. Chaque fois, l’idée d’une chape de plomb étouffant le plus démuni. Et comme l’artiste aime le théâtre qui tache, coups, sang et cris pleuvaient sur la scène du Grütli. Le spectacle disait beaucoup de la rage de son auteur contre la logique du plus fort.
Ici, on retrouve cette colère, mais en creux. Comme si l’artiste avait séché ses larmes et asséché son propos. Sur la scène du Poche, peu de cris, pas de sang. Et pourtant, Fever est ponctué de passages à tabac, d’un suicide et d’un viol. Mais, alors que le Français Vincent Macaigne déchaîne les éléments sur la scène de Vidy dans I diot!, véritable cri d’amour au théâtre (LT du 13.09.2014), Attilio Sandro Palese, d’ordinaire énervé, prend ici de la hauteur, dématérialise sa noirceur. Ses play-boys de pacotille évoluent en suspension, à coups de silences et de temps morts. Pour briser tout naturalisme, le metteur en scène va jusqu’à projeter certaines répliques des protagonistes sur le mur du fond. Un travail froid, donc, aux antipodes de son goût habituel pour le chaos et l’ébullition. Le décor, déjà, annonce ce choix. En lieu et place d’un dancefloor illuminé, le public découvre une cour, grise et grillagée. A la fois terrain vague, à la fois prison. Un lieu qui suscite plus la prostration que la libération. Au début, cependant, il y a du mouvement. Les six protagonistes, impeccablement coiffés et habillés par Sonia Geneux et Tania d’Ambrogio, entrent et sortent du plateau, tels des top models seventies. Sous les chemises à fleurs et pantalons moulants, on découvre ou retrouve des acteurs accrocheurs. Jérôme Denis, fraîchement sorti de la Manufacture, compose Bobby, petite frappe formidablement tête à claques. Aurore Faivre, de l’Ecole des Teintureries, à Lausanne, donne à Annette, la mal-aimée, des jolis airs de pin-up de quartier. Jeune diplômé des Teintureries, lui aussi, Nathan Heude assume sans trembler le rôle de Tony. Il en a la coupe, le tranchant et la mélancolie. Blaise Granget, Julie-Kazuko Rahir et Bastien Semenzato sont familiers des plateaux romands. Malgré leur expérience, ils conservent dans l’allure une belle désinvolture.
Alors oui, au début, vu le chassé-croisé agité et vu les présentations comiques où chaque garçon aligne une déferlante de prénoms, on imagine que la soirée va s’embraser. On attend l’explosion du son, la puissance de la danse. En fait de son, DJ Eagle propose un refrain lancinant qui dit plutôt le mortel ennui. Et le seul moment où l’on entend, au loin, Staying Alive, tube planétaire, c’est pour saluer la mort d’un ami… Idem pour la danse, dont Caty Eybert signe les chorégraphies. Elle est esquissée, effleurée, jamais elle n’atteint la transe.
Ce parti surprend. Et séduit. Car il emmène les spectateurs ailleurs, là où la violence ne peut pas être réparée par une ivresse des sens. On reste sur sa faim de fête, mais, précisément, ce sentiment plombant crée un trouble persistant. A la sortie, le public questionne cette absence d’insouciance. Et l’on parle de la vie qui freine, des failles sociales, des adolescents… Ou quand la fièvre du samedi soir devient le débat de tous les jours. FEVER, À LA VIE, À LA MORT AU THÉÂTRE LE POCHE À GENEVE Valérie Debieux, Lagalerielittéraire.com, septembre 2014
«Je crois qu’il y a une part de magie et de spiritualité dans l’Art. L’Art est le fruit de l’intuition et de l’observation du monde, des gens et des choses. L’Art est la résonance de la totalité de notre psychisme, lorsque celui-ci observe librement le monde. C’est le vide qui observe le vide. C’est l’amour.» Sandro Palese
Fever, à la vie, à la mort est une libre adaptation du célèbre film Saturday Night Fever qui a révélé l’acteur John Travolta et c’est ainsi que, dans la «fièvre» d’un samedi soir de septembre, le Théâtre de Poche a lancé sa saison et quelle réussite énergétique ! La pièce a reçu un merveilleux accueil du public et Attilio Sandro Palese ne peut que s’en réjouir. Les comédiens Jérôme Denis, Aurore Faivre, Blaise Granget, Nathan Heude, Julie Kazuko-Rahir et Bastien Semenzato campent leur rôle à merveille. Un casting excellent pour une pièce tonique, grave, où le rythme est omniprésent.
Aussi fort qu’efficace, ce «dyptique», miroir des années soixante-dix, reflète de façon percutante la morne existence d’une jeunesse qui, passionnée par la danse, tente de mieux exister dans une fureur de vivre qui lui est propre. Tony et sa bande cherchent à s’affirmer et à défendre leur identité dans cette société de Brooklyn. Forts en gueule, adoubés d’un look peu ordinaire, ils touchent le spectateur en plein cœur car ils sont vrais, bruts de pomme et sans tabous. Tout simplement beaux, explosifs et talentueux, ils ont l’insolence de leur jeunesse.
Fever, à la vie à la mort est une création du Théâtre Le Poche à Genève en co-production avec le Théâtre des Célestins à Lyon, la Cie Love Love Hou, avec le soutien d’Interreg France-Suisse de la Fondation Leenaards. Elle est également la quatrième pièce écrite par Attilio Sandro Palese. 30 ANS, LA TRANSE DE LA DANSE Marie-Pierre Genecand, Le Temps Sortir, septembre 2014
Au Poche, à Genève, Attilio Sandro Palese réécrit «La Fièvre du samedi soir»
Attilio Sandro Palese est joliment décomplexé. Lors de la présentation de saison du Poche, en mai dernier, le metteur en scène est arrivé sur scène coiffé d'un casque à paillettes et s'est vautré aux pieds de la directrice, Françoise Courvoisier. Une entrée fracassante qui dit bien le côté no limit du personnage, son appétit pour le langage frontal, sa sensualité. À la rentrée, ce Genevois tendance punk propose Fever, réécriture théâtrale de La Fièvre du samedi soir, film-culte de 1977 où Travolta survolté joue Tony, jeune homme oubliant chaque week-end sa vie étriquée dans une danse endiablée. Au-delà de la chronique d'un milieu populaire, Attilio Sandro Palese souhaite convoquer sur la scène du Poche cette énergie quasi tribale. «J'espère réveiller la danse en chacun de nous. La Vie est rythme et musique. Elle est légère lorsqu'on s'abandonne à son mouvement parce qu'il a lieu maintenant et pour toujours», observe-t-il. Dès lors, le metteur en scène réunit de jeunes comédiens et leur demande de se bouger (Caty Eybert signe les chorégraphies). De rechercher en eux cette force de la transe. Une atmosphère qui pourra rappeler Teenfactory!, précédent spectacle musical du metteur en scène inspiré du groupe Nirvana. Sauf qu'ici, pas de grunge et de t-shirts troués, mais des tenues proches du corps et du glamour doré. Disco! ENTRETIEN SANDRO PALESE Rosine Schautz, Scènes Magazine, septembre 2014
FEVER
À l’instar du film culte qui révéla John Travolta et fit dans la foulée un succès planétaire aux Bee Gees, Fever raconte l’histoire d’un jeune homme de dix-neuf ans, d’origine italienne, qui danse comme un dieu. Tony rejoint sa bande de copains un peu paumés et pas mal désoeuvrés à la disco du coin. Grâce aux sapes, à l’alcool, aux filles et surtout à la musique, ils sortent littéralement d’eux-mêmes le temps d’une soirée, oubliant leur morne vie quotidienne et ses difficultés. Cette pièce raconte également la rencontre sincère car vraie de Tony et Stéphanie, deux solitaires pour lesquels l’amour et la sensualité seront peut-être une réponse…
Entretien avec Attilio Sandro Palese
En quelques mots, qui êtes-vous ? Je suis un homme de 45 ans, fils d’immigrés franco-italiens. Ma formation de comédien m’a amené, peu à peu, à exercer le métier de metteur en scène. Par la suite, j’ai eu envie de me confronter à l’écriture théâtrale. Je voulais être totalement maître des propos tenus sur scène, partager un regard plus personnel sur le monde et m’amuser un peu. Pour moi, l’écriture est aussi une manière de comprendre les mécanismes de ma perception et de les affiner. Fever, à la vie, à la mort est ma quatrième pièce. [...]
D’où votre pièce Fever tire-t-elle son titre? Fever, à la vie, à la mort est un titre inspiré par le film culte Saturday Night Fever. La pièce que j’ai écrite reprend très librement quelques-uns des thèmes de l’œuvre cinématographique. Cette dernière m’a touché par la finesse de sa réalisation. Elle raconte la vie de quelques jeunes, dans une banlieue de Brooklyn, en 1977, qui vont danser tous les samedis soir, pour se défouler et pour donner du sens à leur vie. La fièvre fait référence à un état du corps, où il lutte pour sa survie et tente de se préserver. « Fever » peut être comprise comme une métaphore du combat de notre corps et de notre esprit qui résistent à ce qui les opprime. À la vie, à la mort est un slogan qui symbolise les liens d’une amitié profonde. Ma pièce est un diptyque. La première partie est composée de portraits des jeunes personnages de la pièce qui n’ont pour modèles de survie que des héros de cinéma. La deuxième montre plus prosaïquement leur quotidien sur une semaine. Écrire et diriger, est-ce le même plaisir ? Oui ! Il s’agit en effet de deux plaisirs identiques, mais surtout de deux arts qui exigent beaucoup d’humilité et de travail. Il faut composer avec son amour-propre et celui des autres, savoir s’affirmer sans blesser. Il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier et cultiver une ouverture d’esprit. [...]
|
FEVER |