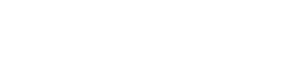|
NOTES D'ATTILIO SANDRO PALESE
Quand j’ai lu Séance de Michel Viala, j’ai tout de suite aimé. C’est fin, drôle, c’est jouissif. C’est même un peu tragique. Ce texte me questionne aussi. Quand je serai proche de la fin de ma vie, quand je me sentirai au bout du chemin, quelles parties de mon passé reviendront me visiter ? Serai-je heureux d’avoir vécu ma vie ? Et si je survis, comment vivrai-je la disparition de tous ceux que j’aime ? De toutes ces mêmes personnes que je rencontre machinalement chaque jour ? Est-ce que j’aurai un dialogue d’amour avec mes enfants devenus grands ? Et comment le vieillard, malade ou pas, souffrant ou pas, vivra la jeunesse des autres ? Serai-je un homme seul mis sur la touche ? Un vieux con ? Comment se transformeront le temps et l’espace que j’ai connus dans ma jeunesse ? Les distances seront-elles plus longues ? Et à quelle vitesse iront mes mouvements ?
Maintenant que je me sens encore vigoureux, quel est mon comportement avec les « anciens » ? Qu’est-ce que je pense d’eux ? Est-ce que je considère les « vieux » comme une race à part…? Pourtant, pourtant je vieillis, ça s’approche, c’est sûr ! Je m’éloigne des « jeunes », même si je suis encore assuré par ceux qui sont plus âgés d’un « mais tu es jeune encore, tu sais ». Une phrase rassurante qui se transforme, peu à peu, par « mais tu n’es pas si vieux que ça, tu sais »… La vision que j’ai du texte de Michel Viala se situe à la frontière subtile entre le réalisme et le grotesque. L’acteur est donc lui-même projeté dans cette zone. Cela promet un jeu très intéressant, où se côtoient l’humour et le tragique. La différence d’âge des comédiens raconte déjà beaucoup. Il y a de la poésie dans ce mélange de générations. Le Théâtre, c’est peut-être le dernier endroit où une telle chose est possible. Des vieux travaillent avec des jeunes, animés par la même joie de créer, de parler des humains, d’incarner des paroles et des corps, avec la même envie de vivre dans le neuf. Avant tout et naïvement, j’espère que le spectacle suscitera cet amour, que nous pouvons tous porter à autrui et à nous-mêmes et pas seulement dans nos bons jours.
CHERS JOYEUX CONTEMPORAINS...
Eva Cousido rencontre Maurice Aufair et Attilio Sandro Palese, tiré des Cahiers du Poche n°9
Avec fulgurance et un humour qui fait la peau à toute tentation d’apitoiement, Séance envoie valdinguer notre société libérale et sa propension à fabriquer de l’exclusion. Ce bijou malicieux signé du génial Michel Viala égratigne au passage certains travers de la Suisse et déboulonne la démocratie bien-pensante. Pour la petite histoire, cette pièce est née d’une commande passée à quatre auteurs par le directeur du théâtre de Bienne et Soleure sur l’acte démocratique de la « séance ». Nous sommes en 1974. Le texte est créé en Suisse allemande, puis dans la foulée, Maurice Aufair le monte et l’interprète en compagnie de Catherine Sumi au Théâtre de Carouge. Succès public et critique. Séance est aujourd’hui une des œuvres les plus jouées de l’auteur romand, ici comme ailleurs. Presque quarante ans plus tard, Maurice Aufair revient sur ce texte qu’il connaît par cœur. C’est à Attilio Sandro Palese qu’il confie la mise en scène et à la pétillante Sabrina Martin qu’il donnera la réplique. Maurice Aufair / Attilio Sandro Palese. À les regarder, ces deux-là, on comprend vite qu’un lien profond les unit, par-delà le théâtre et leur talent. Peut-être leur sentiment de révolte ou leur sensibilité à fleur de mot. À la question : « Vous reconnaissez-vous en Attilio Sandro Palese ? », Maurice répond par un oui répété et un large sourire énigmatique. Nous n’en saurons pas plus. Rencontre dans un café genevois avec deux hommes à la densité bouleversante.
Que raconte Séance pour vous ? Attilio Sandro Palese.- Ce qui m’a touché à la première lecture, c’est l’aspect très humain. L’écriture de Viala est une écriture sur les gens. Nous pouvons tous nous y reconnaître. Derrière la simplicité de l’histoire, il y a une grande complexité : c’est un homme qui est à la fin de sa vie, qui voit disparaître tous ses camarades, tout ce qu’il a connu. Là, il a une dernière révolte. Chaque instant, chaque tournant de notre existence peut être une dernière séance. Le texte m’a fait penser à Beckett, à cause du côté absurde qu’a parfois la vie.
Maurice Aufair.- C’est une des grandes qualités de cette pièce et de tous les textes de Viala d’ailleurs : il a l’art de créer des personnages qui sont près de nous, qui existent, que l’on sent. Ce ne sont pas des concepts mais des personnes en chair, en os.
Séance brasse beaucoup de thèmes, sans avoir l’air d’y toucher. Notamment celui de la démocratie. M.A.- Oui ! C’est un des thèmes les plus forts ! Cet homme a passé son existence couvé par l’administration, habitué au consensus bien helvétique. Et d’un coup, à la fin de sa vie, il se trouve face à quelque chose qui le dépasse et il doit prendre une décision tout seul... un petit coup de rouge aidant !
A.S.P..- Les « Joyeux Contemporains » auxquels il s’adresse alors qu’il est seul dit toute l’ironie de la situation et rappellent peut-être effectivement la population absente de certaines décisions...
M.A.- De là découle la question de la solitude. Mais ce qui est génial, c’est que Viala ne la traite pas de façon nostalgique. C’est une solitude assumée : il faut continuer de vivre, de faire ce que l’on a toujours fait.
Un autre thème est l’opposition hasard / déterminisme. Schmidt fait un pied de nez à la vie, mais la vie le rattrape... A.S.P..- J’y vois une critique humoristique de la Suisse. Même si on abandonne une mallette avec des millions dedans, il y aura quelqu’un pour nous la rapporter. La révolte de Schmidt est rattrapée par le système, par une culture de la politesse, à un tel point qu’on ne perçoit même plus que c’est un acte subversif.
La pièce aborde aussi un phénomène naturel qui est pourtant un peu tabou dans notre société : le fait de vieillir. M.A.- C’est un lieu de tolérance totale. A.S.P..- En tout cas dans l’idéal...
Maurice, vous avez monté et joué Séance en 1974. Pourquoi remonter le texte aujourd’hui ? M.A.- On a parfois envie de revenir sur ce qu’on a apprécié. J’ai eu beaucoup de plaisir à créer cette pièce et surtout à voir l’impact qu’elle avait sur les spectateurs, jeunes ou vieux. Et aujourd’hui, j’ai l’âge du rôle. Plus besoin de me maquiller et de mettre du shampoing sec sur les cheveux !
Votre perception du texte a-t-elle changé? M.A.- Pas tellement. À quarante ans, on comprend déjà parfaitement un homme de quatre-vingt ans.
Attilio Sandro, n’est-ce pas un peu «casse-gueule» d’avoir accepté la proposition de Maurice de mettre en scène cette pièce ? A.S.P..- C’est un avantage de travailler avec Maurice, d’avoir ses retours sur la pièce et sa lecture. D’autant plus que je ne me considère pas comme un dramaturge... ou alors je suis un dramaturge intuitif. J’apporterai forcément une esthétique différente. Comme j’aime faire des liens avec le cinéma, j’ai très vite pensé à Tati et aux frères Cohen. Dans Séance, on se trouve à la limite du banal et de l’extraordinaire ; la situation que vit Schmidt est exceptionnelle, c’est une sorte de purgatoire, d’antichambre entre deux moments de son parcours. Je vais surtout mener un travail de direction d’acteurs avec Sabrina Martin et Maurice. L’important est que l’on sente l’humanité des personnages qui est le cœur de la pièce. Et le défi pour moi qui ai tendance à tout tordre, c’est d’aller vers une simplicité. A.S.P..- Mon envie de faire de la mise en scène est partie d’un conflit intérieur, qui se dirigeait toujours contre un pouvoir : le père, la mère, le pouvoir politique. Et j’ai eu besoin d’exprimer ma colère et ma frustration par l’art. Donc, très vite, les textes que j’ai choisis résonnaient avec ce vécu. Mais je m’ouvre de plus en plus à d’autres univers. Dans Séance, Viala a bien senti l’emprisonnement du personnage principal et son désir d’ouvrir la cage. On retrouve la notion de pouvoir. Sauf qu’ici l’auteur l’aborde sans jugement ni dogmatisme, avec un amour des individus.
M.A.- C’est un peu comme Tchekhov : Viala nous montre les êtres sans les juger. C’est la patte d’un grand auteur. Vous semblez tous deux avoir une relation de filiation, spirituelle et artistique. M.A.- Nous nous sommes rencontrés il y a quinze ans, quand nous jouions ensemble dans un spectacle de Benno Besson. Sandro était le petit, il sortait tout juste du conservatoire. Nous avons tourné pendant plus d’une année, je le traînais avec moi dans différents lieux, des expositions, des églises. Pas du tout pour lui transmettre un message, mais pour partager des petites choses quotidiennes. Ensuite, des années plus tard, on s’est retrouvé sur un spectacle où Sandro était assistant à la mise en scène. Il disait des choses très justes et j’avais pleinement confiance en lui et en son regard. Quand il s’est agi de remonter Séance, j’ai tout naturellement pensé à lui... Sachant que je vais être bousculé et c’est tant mieux ! J’ai envie de quelqu’un qui porte un regard neuf sur cette pièce.
A.S.P..- Quand j’ai rencontré Maurice sur le Benno Besson, j’étais un peu perdu, j’avais plein d’a priori sur le théâtre notamment. Chez Maurice, j’ai trouvé une liberté de penser, une jeunesse et un amour de l’art sous toutes ses formes qui m’ont ouvert au monde. Le regard qu’il pose sur les choses, sa passion, son intelligence ont adouci la violence que je portais. Maurice m’a souvent parlé du théâtre qu’il faisait dans les années 1960, des textes qu’il montait alors. Il m’a fait découvrir toute une page de l’histoire du théâtre en Suisse que je ne connaissais pas. C’était subversif, j’y ai vu un côté punk que j’aime. Maurice est aussi le premier à m’avoir dit : « Si tu veux monter Macbeth, vas-y, fonce ! » Alors qu’on me servait toujours le discours comme quoi j’étais trop jeune et qu’il fallait attendre. Vous disiez à l’instant faire souvent référence au cinéma dans vos spectacles. Pourquoi ? A.S.P..- C’est la première chose que j’ai regardée, enfant. Ce que j’aime dans le cinéma avant tout, c’est le montage. Si je réalisais mes mises en scène au cinéma, elles seraient très réalistes. Mais dans un théâtre, elles paraissent grotesques - du moins, c’est ce que l’on me dit -, à cause de l’attention portée aux gros plans entre autres. Le principe de réalité admis au cinéma n’a rien à voir avec celui qui régit la scène. Cela dit, à regarder de plus près, c’est la vie qui est grotesque. Quand on voit certains politiciens se pavaner, c’est très théâtral, non ? Et je dis cela sans porter aucun jugement moral. C’est vrai aussi que j’ai envie de bousculer les formes et le consensus sur comment on doit faire du théâtre. Je ne veux pas de cet enfermement. Le théâtre doit rester un lieu de la pensée critique, où tout est permis.
La saison prochaine vous donnerez un stage au Grü. Dans la note d’intention, vous indiquez qu’il s’agira d’«organiser les sensibilités». Est-ce cela, pour vous, mettre en scène ? A.S.P..- André Steiger disait qu’il gérait les désirs de chacun. Mais c’est un idéal. Car de plus en plus, je me rends compte que je suis un « tortionnaire », je suis têtu, je dicte. Même si profondément, je suis gêné de molester les acteurs ainsi. Je me sens plus artiste que metteur en scène... si ce n’est pas un trop grand mot. Le théâtre est ce qui se présente à moi aujourd’hui, mais s’il le faut je m’exprimerai par d’autres médias. J’ai envie de participer à la Cité, à la marche du monde, de réagir à ce qui m’entoure. C’est un peu l’envie de changer le monde... En cela, Maurice, vous devez vous reconnaître. M.A.- C’est sûr que quand nous avons commencé à faire du théâtre, à la fin des années cinquante, avec la troupe de l’ancien Théâtre de Carouge, nous voulions chahuter le théâtre établi, nous voulions déranger les conventions. François Simon, Roland Sassi, Philippe Mentha, nous étions tous politisés, il nous semblait que le théâtre était le seul moyen de faire bouger les choses. Nous ne montions jamais un texte sans nécessité. C’était un combat, une conviction, nous défendions des textes, des auteurs. Il fallait se cramponner alors pour monter un Beckett, un Pinter. D’autant plus que nous n’avions pas d’argent.
Vous êtes un guerrier de la scène ! M.A.- Il ne faut pas exagérer ! Il y a aussi et simplement l’immense plaisir à être sur scène.
De quoi est-il fait ce plaisir ? M.A.- De liberté et de la conscience du lien qu’on établit avec le public, un dialogue qui s’affine encore avec l’âge. Quand on est jeune comédien, on fonce, on va trop vite, on balance le texte, on sort de scène et puis c’est fini. Maintenant, je prends plus de plaisir dans les temps, les silences. Avec l’âge, on dit les choses plus posément, même les plus violentes, on a conscience de ce que l’on fait là avec le public, comme un toréador.
Votre nom d’origine est Hofer. Pourquoi l’avoir francisé ? M.A.- Jeune homme, j’avais un amour démesuré pour tout ce qui était français, la culture, la littérature. J’avais dévoré Gide, Camus, Sartre, je courais en France dès que je le pouvais. Hofer est le nom de mon père. Il appréciait moyennement que je fasse du théâtre. Ma grand-mère, elle, portait le beau nom de Mathilde Aufranc. J’ai alors modifié mon patronyme.
Vous avez l’air d’un jeune homme. Le théâtre est-il un antidote contre le temps qui passe ? M.A.- Sans doute... La propriété extraordinaire du théâtre, c’est sa capacité de changement, de bousculer le présent, le passé, d’être résolument tourné vers l’avant. |
SÉANCE |