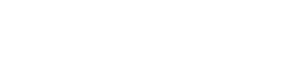|
TOUCHER LES BLESSURES...
Suzane Vanina, rueduthéâtre.eu, 27 février 2012
Le titre gentillet laissait entrevoir une belle histoire à raconter aux petits enfants, mais cette maman-là n'a rien d'une douce mère-grand car le conteur-dramaturge a voulu « ramener la guerre à la maison » avec un petit soldat qui est le jouet... de puissances de mort qui le dépassent. Un décor pauvre, sombre, moche ; juste un portrait lumineux pour l'éclairer, et c'est comme une présence pour une mère en costume de mamma, qui attend, comme toutes les mères de la terre, son fils soldat « en opération » au loin. L'image, résumé de vie et de mort, reste fixe, longtemps, comme une photo, pour imprimer nos rétines.
Une porte, une seule. Elle sera tour à tour accès vers l'intérieur ou vers l'extérieur, et surtout vers une nuit cauchemardesque. Des passages brutaux de vie, avec l'incursion d'un jeune soldat, alterneront avec de lents passages d'attente, et des phrases, répétitives, des injonctions, toujours les mêmes: «Where is the papa»... vont peu à peu nous déconnecter d'un réalisme plus habituel. La nuit, les nuits, seront longues.
Le trio composé de deux femmes (une vieille, une jeune) et d'un homme (jeune) est vu par les yeux du «Fils» et c'est donc de «la Mère» et de « la Sœur » qu'il faut parler. Dépassé, bousculé, ce trio s'entrechoque avec un autre (reflet ou réel) et, dans cette ambivalence, les trois protagonistes aux identités interchangeables vont devenir des symboles de tous les manques, de tous les déchirements familiaux. Symbole encore que ces deux femmes qui s'éclairent elles-mêmes par moments comme pour dire qu'elles veulent sortir de l'ombre, qu'elles existent !
L'auteur, Gilles Granouillet, voulait « simplement » rappeler que la guerre c'est autre chose qu'un jeu vidéo ou des images relayées par tous les (sélectifs...) « moyens modernes de transmission », que la guerre c'est autre chose que ces mots devenus banals, quotidiens : « frappes sélectives et limitées », « missiles de croisière » (!). Faire ressentir l'horreur, réellement, reste un but louable mais utopique sans doute parce que, par une protection archaïque, l'intolérable est rejeté de nos perceptions. Il nous faudra dépasser un certain confort de spectateur blasé pour bien entendre ce qu'est : explosion, bruits de bottes et interpellations, interrogatoire, chair, sang, cruauté gratuite, tortures... pour écouter la plainte étouffée - « docteur, docteur » - ... et voir qu'il y a mort d'homme « sous le dattier »...
Sans que rien ne permette de situer exactement l'action, nous saurons que c'est une guerre actuelle qui broie les hommes à l'extérieur comme à l'intérieur, militaires comme civils. Un village occupé, oui sans doute, une maison vide du père, oui aussi, un soldat comme un méchant gamin perdu, oui certainement. Ici, ailleurs, une guerre qui est ou a été sera la même partout... Et les « dommages collatéraux » continueront à couvrir des horreurs.
Un sujet, grave pour la scène, devient ici comme un grand poème lyrique, une élégie superbement et subtilement éclairée portée par un jeu d'acteurs intense.
Cette création a vu le jour à Genève, la Suisse du « Traité de ... », en pays de la paix avant de revenir dans la patrie du metteur en scène Philippe Sireuil. On retrouve son style parmi les plus originaux, reconnaissable notamment par une volonté sans cesse réaffirmée de s'attaquer à des textes puissants, pas toujours faciles d'accès, qu'il entend lui-même porter à la scène d'une manière sobre, presque ascétique. C'est ainsi que sont respectées à la lettre chaque syllabe, que le côté monocorde est entièrement assumé, que les dialogues peuvent ressembler à un long monologue incantatoire et poétique.
Une autre caractéristique est son implication totale dans les arts de la scène, particulièrement la lumière, qu'il entend manipuler lui-même, ou en collaboration avec un autre amoureux des clairs-obscurs, des noirs osés, des vagues reflets et des éclats soudains. Toute une gamme qui se décline savamment, mettant chaque scène en valeur.
Directeur d'acteurs exigeant, il a rencontré les jeunes Edwige Baily et Felipe Castro et, plus surprenant, Roland Vouilloz pour une « Mère » tout à fait crédible, enfermée en elle-même, énigmatique et troublante. Pourquoi une mère encourage-t-elle la « chair de sa chair » à devenir de « la chair à canon » ? L'amour de la patrie peut-il être une motivation pour un jeune aujourd'hui, ou voit-il l'armée comme un secteur riche en offres d'emploi ? Le métier de soldat comme remède au chômage ? Et ce « métier », un exutoire à un manque de créativité personnelle, à une incapacité à grandir, à « devenir un homme » par ses propres moyens ? Un pays, quel qu'il soit, est-il concerné par des conflits lointains et requis à un « devoir d'ingérence » ?
Toutes ces questions et encore bien d'autres surgiront après ces visions scéniques fortes, alors que « nos » guerres ont changé de visage et qu'il n'est plus question, en principe, d'«Armée» combattante, mais de « Défense » dont on réduit les effectifs humains tout en perfectionnant les engins destructeurs ... Cruel paradoxe.
LA MAMAN ET LA GUERRE
Face à la guerre, une mère troublante et monumentale dans le nouveau Sireuil.
Guy Duplat, La Libre Belgique, 10 février 2012
[…] L’écriture de Gilles Granouillet [...], parfois désarçonnante, mêl[e] le poétique au politique, l’intime et le général. Il raconte l’histoire tragique de la guerre faisant irruption dans une famille. C’est la nuit, un soldat frappe à une porte : "Je suis venu te voir, Maman, c’est ton fils qui est là." Un blindé vient d’exploser. Le soldat pénètre dans une maison où se trouvent une mère et sa fille. "Where’s the papa" ? interroge-t-il. C’est sa première mission, il veut le réconfort de sa mère et de sa sœur. Sont-elles celles qu’on voit ? Sa sœur est-elle cette fille qui elle aussi est réveillée par l’explosion et appelle "Maman" ? Dans un huis clos qui mêle réalité et imaginaire, on voit la souffrance du soldat confronté au sang. Celle de la fille, et surtout la mère, bloc imposant mais tétanisé, fissuré. De manière géniale, le rôle a été confié au grand acteur suisse Roland Vouilloz. Il/elle se rend compte que son fils a tué et violé, que ses principes d’éducation ont été vains, que sa fille sera violée. Elle ne veut rien voir, rien assumer de ses propres erreurs, juste pouvoir faire comme chaque samedi, ses courses au Lidl. Et pendant ce temps, le chat est tué... Cette écriture ne dit pas tout, sauf l’essentiel : que la guerre s’inscrit autant dans les âmes et les familles que dans les images chocs des journaux. Elle pollue le monde. Pour ce spectacle, Philippe Sireuil et le scénographe Vincent Lemaire ont conçu un espace resserré avec des murs décrépis, couleur sang. Au bout, une porte, celle de nos espoirs obstinément fermés, celle qui mène à l’enfer plus qu’au paradis. Les éclairages aussi comptent : les plongées dans le noir qui permettent de passer du soldat à la fille, du réel à l’imaginaire. Les deux femmes éclairent leurs visages tandis que le soldat reste dans le noir, visage noirci. Avec Felipe Castro dans le rôle du soldat et une excellente Edwige Baily dans celui de la fille. […] PHILIPPE SIREUIL, CONDUCTEUR DÂMES
Le metteur en scène belge est un directeur d’acteurs d’exception. Il le démontre ces jours encore au Poche de Genève, où il crée La Maman du petit soldat. L’artiste raconte son amour du jeu.
Alexandre Demidoff, Le Temps, 1er février 2012
D’un corps, il fait un climat. D’une voix, un courant. Le Belge Philippe Sireuil est un directeur d’acteurs d’exception. Ce n’est pas lui qui le dit. Mais ses spectacles. Nouvelle démonstration: La Maman du petit soldat, à l’affiche cette semaine encore au Poche de Genève. Du talent de Philippe Sireuil, La Maman du petit soldat est un précipité. Le metteur en scène ne révèle pas seulement un auteur d’aujourd’hui, le Français Gilles Granouillet. Il crée un monde à part. Le sujet? Une mère attend des nouvelles d’un fils parti à la guerre. L’étrangeté tient notamment à ceci: la mère est incarnée par un homme, l’acteur Roland Vouilloz; et la nuit de l’attente est clapoteuse, état de veille ou cauchemar, on ne sait jamais très bien. Appelons cela un biotope. Philippe Sireuil, 60 ans cette année, a des mains de garde forestier et l’aube dans les yeux. Son métier, depuis le début des années 1970 à Bruxelles, mais aussi à Zurich ou à Genève, est d’éclaircir la forêt que constitue souvent une œuvre contemporaine. Au Poche, il a monté Les Guerriers (1999) de Philippe Minyana et Les Mots savent pas dire (2005) de Pascal Rebetez, spectacles qui sont des entailles pour ceux qui les ont vus.
Le Temps: D’où venez-vous? Philippe Sireuil: Je suis né au Congo belge, à Léopoldville, en 1952. Mais je n’ai de l’Afrique aucun souvenir. Les seules images que je conserve, ce sont celles des films super-huit de mon père. S’il y a un pays d’où je viens, c’est la France. J’ai vécu à Versailles jusqu’à 15 ans. J’aime que la France soit ce pays où les artistes et les intellectuels ont une place, ce qui n’est pas le cas de la Belgique.
Mais c’est à Bruxelles que votre nom est associé, à la tête notamment du Théâtre Varia. Oui, parce que ma famille s’y est établie en 1967. Et parce que j’ai eu la chance de me retrouver dans un collège où bouillonnaient déjà les idées de Mai 1968. Mes professeurs de français et de dessin ont été déterminants. A cause de mon père, peut-être, qui était docteur en chimie, je me voyais ingénieur. Et puis voilà qu’à 17 ans je me retrouve à suivre une formation théâtrale. A 20 ans je travaillais, et je n’ai pas arrêté. J’avais envie de tout faire. Construire les décors, concevoir les lumières, bref, vivre le métier.
Qu’attendiez-vous du théâtre? Je suis entré à l’école avec Théâtre et combat du critique français Gilles Sandier. C’est grâce à ce livre que j’ai découvert que le théâtre, c’était des regards sur le monde. Au début des années 1970, j’étais marqué par la pensée marxiste, celle que Bertolt Brecht avait médiatisée dans ses pièces. Nous nous formions en allant voir les spectacles des metteurs en scène que nous admirions, je me rappelle nos virées à Strasbourg, de Vichy, fiction, par exemple, de Bernard Chartreux.
Vous montez beaucoup d’auteurs contemporains. Pourquoi? J’aime être désarmé par un texte. Quand j’ai lu La Maman du petit soldat, j’ai été frappé par le caractère obscur de l’écriture. Ce qui est moteur chez moi, c’est souvent ça: l’impression que je n’arriverai pas à monter la pièce, que je ne trouverai pas les clés.
Que demandez-vous aux acteurs à la première répétition? Qu’ils connaissent leur texte parfaitement, pour qu’on passe tout de suite à l’essentiel. Je demande aux acteurs de jouer sur scène toute la pièce, sans pause. Cette traversée, c’est un premier matériau pour eux et pour moi. Nous créons un pot commun d’hypothèses. Vous n’avez donc pas d’avis préconçu sur le texte? Non. C’est l’acteur qui me révèle ce que je pense de la pièce. Il faut que je le voie marcher pour qu’une vision du texte s’affirme. Je me méfie des théories préalables. Patrice Chéreau dit qu’une idée qui n’est pas matérialisée n’existe pas.
Vous êtes toujours l’éclairagiste de vos spectacles, ce qui est rare. Pourquoi? Je ne peux pas déléguer la lumière, c’est physique. Eclairer, c’est guider le regard du spectateur, donner le premier point de vue.
Que voudriez-vous que vive le spectateur à travers La Maman du petit soldat ? Je fais des spectacles pour toucher le public. L’écrivain Botho Strauss dit que le théâtre permet d’entendre l’infime dans le tohu-bohu. C’est ce que j’essaie de faire, donner à entendre un murmure. LA VIEILLE, LA GUERRE ET SES ENFANTS
Au Poche à Genève, l’acteur Roland Vouilloz est magnifique en mère fissurée par l’angoisse. Critique.
Alexandre Demidoff, Le Temps, 1er février 2012
Comment dire la guerre, ce qu’elle fait à ceux qui la vivent, à ceux aussi qui attendent les nouvelles du front? Comment faire passer l’effroi de cette expérience, sans la réduire à une image ou à un discours? La Maman du petit soldat est portée par cette ambition. L’auteur, Gilles Granouillet, donne à sentir l’onde de choc qu’est toujours la guerre pour ceux qu’elle touche, de très près ou de très loin. Au Poche, dans la mise en scène de Philippe Sireuil, c’est ce choc qu’on éprouve d’abord: un gong obsédant et cette impression que la nuit bouge, chahutée par une fureur lointaine. Mettre en scène, c’est rêver un climat, lui donner une vérité physique aussi. A présent, c’est un halètement qu’on entend. Puis une voix de garçon perdu: «Maman, maman.» Puis celle d’une fille, feu de joie dans la nuit: «J’ai entendu une explosion. Quelque chose a explosé dans la rue.» Ces deux enfants sont frère et sœur. Lui est à la guerre, engagé dans une opération de maintien de la paix; elle, elle attend auprès de sa mère. La mère, justement, est un bloc sanglé dans une jupe de chagrin. Philippe Sireuil a confié le rôle à Roland Vouilloz. De cet acteur, il dit qu’il est l’un des plus puissants de sa génération. Et c’est vrai que Roland Vouilloz a ce talent rare: faire remonter des sentiments qui n’ont pas de nom. Il faut le voir en veilleuse tétanisée, sous un néon de cuisine, poids presque mort. Il se fissure, c’est l’impression qu’il donne, assis sur une chaise, genoux serrés comme à l’église, visage cisaillé par l’ombre. Cette mère ne vit plus, c’est ce que suggère la mise en scène. Elle cauchemarde: son fils (Felipe Castro) a violé et tué, il va mourir; sa fille (Edwige Baily) essaie de la ramener au quotidien, les courses à faire au supermarché du coin. Est-ce que tout cela a vraiment lieu? La qualité du spectacle est là: il donne aux mots de Gilles Granouillet un corps incertain, corps de détresse qui tangue entre songe névrotique et saignée avérée. Au théâtre, la guerre est un écho, juste ça, mais parfois terrifiant. PHILIPPE SIREUIL, EN ALERTE
Au Poche, à Genève, le metteur en scène belge monte La Maman du petit soldat du Français Gilles Granouillet. Travail magistral, fructifié par quarante ans de métier.
Cécile Dalla Torre, Le Courrier, 21 janvier 2012
« Ça n’a pas l’air d’être la journée facile aujourd’hui, techniquement parlant », lance le metteur en scène lors de cette répétition de La Maman du petit soldat de Gilles Granouillet, finalement affranchie du wi-fi – pour la musique – et de la porte qui devait cadrer avec le décor. Noblesse dans la voix, qui résonne sur le plateau du Théâtre de Poche, à Genève : Philippe Sireuil a cette éloquence des hommes de théâtre ayant pénétré les monuments de la littérature dramatique, à l’instar de Bérénice, montée au Théâtre de Carouge en 2009. En quarante ans de mise en scène, il aura tutoyé Racine, Shakespeare, Tchékhov, ou Duras encore récemment sur les planches parisiennes. La scène lyrique s’offre aussi souvent à lui – Verdi avec l’Opéra de Lausanne il y a deux saisons -, bien que le théâtre demeure sa patrie. Aussi aborde-t-il la soixantaine – qu’il ne fait d’ailleurs pas – sans se reposer sur le savoir-faire acquis au fil des années. Celles de ses débuts, à Bruxelles, après une adolescence en France et une prime enfance au Congo, étaient déjà estampillées « mise en scène » à 17 ans, voie suivie à l’INSAS, l’école de théâtre bruxelloise. Curieux, jamais en repos, l’artiste passe du théâtre contemporain à celui de répertoire, des petites formes aux grandes, du plateau de théâtre à celui de l’opéra. « Il y a plusieurs spectateurs dans l’homme, plusieurs centres d’intérêt dans la personne. Je n’échappe pas à cette règle ! » dit-il à l’heure d’un café au bar du théâtre entre deux répétitions.
Le théâtre, à l’aune des différences La dynamique du mouvement insuffle aussi sa propre vie, entre la France, la Suisse et la Belgique, son port d’attache – si tant est qu’il en possède vraiment un en dehors de l’amarrage dramatique. En terres helvétiques, qu’il a déjà largement imprimées de sa facture théâtrale, il se sent bien, au point d’envisager un temps de s’y installer. Et de mentionner sa candidature à la direction de la Comédie de Genève, avec laquelle se dessinent aujourd’hui des projets. Contradictoire de vouloir empoigner les rênes d’une institution de cette veine ? Vraisemblablement pas, d’autant que s’il avait endossé pareilles responsabilités, sans doute Philippe Sireuil se serait-il méfié des « intégrismes programmatiques » ainsi qu’il l’a fait à la tête du Théâtre Varia. « Car la société est faite de différences et le théâtre doit être à l’aune de cela. » Cet établissement qu’il a co-fondé à Bruxelles il y a trente ans, il le quitte en 2000, dans l’idée de ne pas « achever » son travail artistique dans le lieu qu’il a contribué à créer. Perpétuellement sur le qui-vive, le metteur en scène n’a de cesse de rebondir. « Seule l’inquiétude est vraiment capable de remplir un homme, contrairement à la joie. » Il se fond dans ces mots de Botho Strauss, qu’il fait souvent siens lors de ses interviews.
Champ des possibles contemporains S’il noue des fidélités littéraires avec son compatriote Jean-Marie Piemme depuis plus de vingt ans – il montera l’un de ses textes en Suisse l’an prochain -, ce grand nom de la scène belge défriche aussi ailleurs les champs des possibles contemporains. Preuve en est cette rencontre avec le texte complexe de Gilles Granouillet. « L’écriture dramatique dans laquelle je me sens bien, c’est celle qui me dépasse un peu. Avouer que l’on ne sait pas par quel bout la prendre et le revendiquer pour conduire des œuvres est vertigineux, et assez passionnant. » L’incubation du texte de La Maman du petit soldat, rendue possible par un travail en deux temps, n’est cependant pas une constante. Mais peut-être donne-t-elle une « sérénité » à l’ensemble et contribue-t-elle à cette justesse d’interprétation de Roland Vouilloz et Edwige Bailly, avec lesquels Philippe Sireuil apprécie travailler – bien qu’il s’avoue « peu clanique », « ouvrant le cadre » à un brillant Felipe Castro, pour la première fois dans sa distribution. Familier du Poche après trois mises en scène de ses contemporains – Jean-Marie Piemme, Philippe Minyana et Pascal Rebetez -, Philippe Sireuil y avance par tâtonnements depuis cette seconde phase du travail entreprise mi-décembre. Ne peut-il savoir que le fruit de son exigence sera largement salué par le public, et par l’auteur français présent ce lundi de première pour voir la pièce encore jamais montée en Europe ?
Misère sociale La Maman du petit soldat, par sa « matière délicate à manipuler », avait intrigué le metteur en scène. Sans être à message ni moraliste, l’œuvre dit la violence de la guerre et ses ravages sur les sujets humains. Dans le microcosme d’une famille prolétarienne, devenir soldat semble la seule issue à la misère sociale. La guerre y est saisie au plus profond de l’intimité de ses personnages : une mère, un fils, une fille, baignés dans une confusion relationnelle absolue, en constants aller-retour entre un ici et un hypothétique là-bas. Ravivant le spectre de Paul Claudel qui aimait « tripatouiller les textes », Philippe Sireuil ne se contente pas de questionner « cette littérature qui résiste, avec son obscurité qu’il ne faut pas forcément chercher à éclairer », mais demande chaque fois aux auteurs auxquels il s’attèle de « remettre un peu sur le métier l’ouvrage ». Une fois quelques passages réécrits, les acteurs s’emparent avec lui du texte, sans toutefois changer une ligne, comme c’est le cas ici, d’autant plus que la version initiale n’était pas séquencée. Car la création artistique s’accommode mal du figé – l’une de ses tournures qui file l’élégance. Mozart n’était-il pas capable de réécrire un air d’opéra dans la nuit lorsqu’il ne pouvait compter sur l’interprète voulu ? Caressant les euphémismes, Sireuil ne lésine par sur un franc-parler un brin ironique à l’intention de ses comédiens, qu’il dirige de façon très précise tout en leur octroyant une grande liberté. Directif, sans être dirigiste ? Loin du jeune metteur en scène qui voulait jadis tout cadrer, Philippe Sireuil épouse aujourd’hui son travail avec plus de nonchalance. La Maman du petit soldat, pièce saisissante à découvrir en Vieille-Ville, vérifie sans doute ce postulat de Jean-Pierre Vincent, qu’il aime aussi citer : « Mettre en scène, c’est savoir faire mais c’est aussi laisser vivre ».
GUERRE ET PÈRE
Lionel Chiuch, La Tribune de Genève, 18 janvier 2012
C’est une guerre. Ni celle-ci, ni une autre. Une guerre d’échos intimes, imaginée par Gilles Granouillet. En mission, un jeune soldat pénètre dans une maison où vivent deux femmes. L’une est la mère, l’autre la fille. En fait, toutes les mères et toutes les filles. Ça tombe bien, le soldat est tous les fils. Il n’y a que le père qui est absent. Jamais là, les pères. D’où la mission du soldat, qui consiste à savoir où sont passés les hommes… Freud sous les bombes ? Pas vraiment. En dépit de son côté énigmatique, le texte trouve sa résolution dans l’optimisme. L’homme y tournoie, oui, mais toujours dans les limites de son espèce. Moins féroce que déboussolé. Pas encore nihiliste, pas tout à fait sauvage, il cherche essentiellement à combler une absence. Celle du père, donc, et cela le désigne comme élément d’une structure encore valide. Ce qu’il a laissé là-bas, il le dérobe ici, en violant l’adolescente qui pourrait être sa sœur. D’une écriture sèche et efficace, Gilles Granouillet nous parle de l’universalité du meurtrier comme de la victime, de leur interchangeabilité et de l’aveuglement de tous face à cette ironie. Pour soutenir le propos, Philippe Sireuil signe une mise en scène subtile aux climats tout en nuances. Une machine à café lui suffit pour bâtir une ambiance et, par ce biais, accéder à l’intime d’un individu. C’est remarquable, au même titre que la direction d’acteurs. Edwige Baily, Felipe Castro et Roland Vouilloz (dans le rôle de la mère) sont d’une prodigieuse justesse. Puissant comme le souffle de la bombe. |
LA MAMAN DU PETIT SOLDAT |