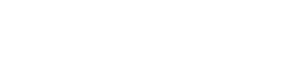|
NOTE DE PHILIPPE SIREUIL
Dès le titre, on fait fausse route. On a beau savoir que l’écrivain est un auteur dramatique, on pense plus à un conte pour enfants, à une histoire à lire pour apaiser le sommeil du petit garçon plutôt qu’à une pièce de théâtre. En fait de sommeil, le nôtre va être agité, mais on ne le devine pas encore … On ouvre le livre, on y découvre les personnages, Le Fils, La Mère, La Fille, on se dit qu’il n’y a pas là de quoi fouetter un chat, que c’est à une énième histoire de famille, à ses atermoiements et à ses variations que la pièce nous convie. On est loin de se douter de ce qui nous attend … On feuillette encore et on commence à lire ; et à cet instant, le piège tendu dès le titre par Gilles Granouillet, se referme sur vous inexorablement. Tour à tour, on va partager les crieries du fils, les dénégations de la mère, les terreurs de la fille, on va transiter de la cuisine d’un pavillon de banlieue française aux sables mouvants et rocailleux d’un conflit pour la paix, d’une nuit étoilée sous les dattiers à celle qui précède les courses du samedi au Lidl, de la réalité du soldat à la fiction de la fille - à moins que ce ne soit l’inverse ! - et ce chat qu’on pensait ne pas devoir fouetter à l’ouverture du livre, on le verra apparaître au détour d’une page, d’abord dans le récit de la sœur, puis dans la main du jeune soldat, écrabouillé par son talon … La pièce achevée, on n’en sort pas. Ou plutôt on ne sait pas exactement comment en sortir, ce que ça raconte, ce qu’il faut en penser. On est là face au bouquin comme retenu et expulsé à la fois, bousculé par la dualité qui règne sans avertissement au fil des pages - les rôles, les temps, les lieux sont tous innervés par le dédoublement -, l’écriture bousculant elle-même les frontières entre quotidien et poétique. On pense alors à ce qu’a dit l’écrivain, qu’il a voulu « ramener la guerre à la maison », qu’il s’est demandé « comment écrire pour qu’on ne puisse pas se dire : oui, c’est bien triste la guerre des autres, la guerre de là-bas, bien triste, mais au fond, c’est bien loin tout ça… », que cette pièce, pour lui, « n’éclaire aucun conflit particulier, mais essaie de nous faire sentir les choses de l’intérieur ». On se dit que son ambition est belle, que ça vaut la peine d’aller y voir plus profond, qu’on a envie de la partager, et de la faire partager.
Philippe SIREUIL
TOUTES LES MAMANS DE TOUS LES PETITS SOLDATS Éric Eigenmann, extrait des Cahiers du Poche n°9
Ce sont les fils qui font la guerre, au front, où les ont envoyés les pères. Pour le théâtre déjà, Wajdi Mouawad en avait tiré l’un des motifs de Ciels en 2009 : « Vainqueur sacrificateur / On appelle cela un État ! / Voyez le sang : qui ordonne qu’il soit versé ? / Les pères les pères / Qui l’a versé ? / Les fils les fils » Et ces fils, au front, tuent des hommes et des femmes qui pourraient être leur père, leur mère, leur frère ou leur soeur, ils tuent des enfants qui pourraient être les leurs. Comment y penser sans frémir ? Ce sinistre jeu de miroir, Gilles Granouillet l’a mis en scène en 2010 dans La Maman du petit soldat par le biais d’un vertigineux rapprochement entre, pour le dire vite, deux familles ennemies. Et le miracle opère : ce que trahissent en définitive tous les personnages, c’est un grand besoin de tendresse qui contribue à faire basculer cette pièce a priori guerrière dans un registre intime.
Tous les personnages ? À vrai dire ils ne sont que trois, mais chacun en recèle un autre, et derrière cet autre se profilent toutes les mères, tous les fils, toutes les soeurs... La Mère, le Fils (soldat) et la Soeur sont en effet les protagonistes annoncés de l’action. Le jeune homme fait irruption, de nuit, dans la maison des deux femmes, où l’absence du père comme de tout homme le fera hurler : « Il faut que je sache où sont passés les hommes dans cette maison… WHERE IS THE PAPA ? » Que la relation de parenté tiennent lieu d’identité à tous les trois confirme bien le point de vue privilégié par l’auteur, de même que la position centrale attribuée au soldat : c’est par rapport à lui que les femmes sont nommées ainsi.
Mais la situation se brouille dès lors qu’il s’exprime et se comporte tantôt comme le fils de la maison parti à la guerre, tantôt comme un soldat en mission dans un village occupé. Tout se passe comme si, de part et d’autre de la ligne de démarcation, deux situations similaires – un jeune militaire faisant une descente dans une maison ennemie, où vivent une mère et sa fille – se télescopaient.
« J’ai écrit La Maman du petit soldat en voulant ramener la guerre à la maison, déclare l’auteur. Comment écrire pour qu’on ne puisse pas se dire : oui, c’est bien triste la guerre des autres, la guerre de là-bas, bien triste mais au fond, c’est bien loin tout ça… Cette pièce n’éclaire aucun conflit particulier, mais elle essaie de nous faire sentir les choses de l’intérieur ».
Si Eschyle au Ve siècle avant J.-C., dans Les Perses, transportait le public athénien sur le sol ennemi, donnant à voir et à entendre les Perses chez eux, l’identité des personnages est ambivalente ou, mieux, instable dans La Maman du petit soldat ; ils oscillent entre deux camps mal déterminés, comprennent la langue de l’autre et ne la comprennent pas, sinon lors d’un improbable passage par l’anglais, fausse langue universelle. C’est que, dit le fils à sa mère, « je ne suis pas tout à fait là… Je ne suis pas dans la maison. Je suis là-bas. Cette nuit j’avais envie de te voir ».
Un fils présent sans l’être, voilà qui évoque cette fois L’Illusion comique de Corneille. Le dramaturge du XVIIe siècle est sans doute le premier à avoir représenté sur la même scène – mais dans un espace-temps incertain – un parent (le père en l’occurrence) et son fils, parti de la maison lui aussi. Le théâtre, au XXIe siècle comme au XVIIe, possède ce pouvoir magique de se jouer des distances, qu’elles soient spatiales ou temporelles. Il peut aussi les rappeler au moment le plus (in)opportun. D’autant plus qu’il rapproche par ailleurs d’autres mondes irréductibles en mêlant à la fiction la réalité tangible de la présence scénique. Il en va ainsi de La Maman du petit soldat de Gilles Granouillet. Rêve, vision, télépathie ? Théâtre, tout simplement. NOTE DE GILLES GRANOUILLET
J’ai écrit La Maman du petit soldat en voulant « ramener la guerre à la maison. » Comment écrire pour qu’on ne puisse pas se dire : oui, c’est bien triste la guerre des autres, la guerre de là-bas, bien triste mais au fond, c’est bien loin tout ça… Cette pièce n’éclaire aucun conflit particulier, mais elle essaye de nous faire sentir les choses de l’intérieur. Elle s’appuie sur un trio « antique » : la mère, le fils aîné, la petite sœur. Une chose simple, essentielle, la famille qui se vit de Bagdad à Montréal et qui, l’espace d’une nuit, se voit retournée dans tous les sens. Il n’y a plus une mère d’ici et une mère de là-bas, une sœur d’ici… il y a une famille d’ici et de là-bas qui prend la peur en pleine figure, au même moment. Jusqu’ici, comme pour nous, la guerre passait à côté et puis ce soir elle est rentrée chez eux.
« Peut-elle rentrer chez moi ? » Pour ma première pièce, c’est un peu la question posée. LA MAMAN DU PETIT SOLDAT Rosine Schautz, Scènes Magazine, décembre 2011
Un soldat, très jeune ; une guerre, peut-être l’Irak, le Kosovo. Qu’importe ! Les confits se ressemblent et sont souvent sans nom. Le jeune soldat pénètre dans une maison, vide de ses hommes, et crie « Il faut que je sache où sont passés les hommes dans cette maison… Where’s the papa ? ». Mais les hommes ne sont plus là, plus nulle part. Ce soldat a reçu l’ordre d’interroger l’adolescente et la vieille femme qui vivent dans cette maison. Soudain, cette première mission le fait penser à sa propre mère er à sa sœur, à mille lieues de là, et à un point tel qu’il a l’impression de les voir véritablement dans ces visages étrangers. D’une phrase à l’autre, le spectateur est immergé dans une sorte de téléscopage spatiotemporel, englouti dans un rêve éveillé, et sans s’en apercevoir formellement, comprend qu’il entre en somnambule dans les limbes d’une histoire qui pourrait, pourquoi pas, être la sienne, mais qui est surtout celle du soldat, celle de la mère et de la sœur, personnages qui représentent aussi d’autres soldats, d’autres mères, d’autres sœurs. Car où sommes-nous ? Qui parle, là ? Et à qui ? Sommes-nous simplement dans un cauchemar ? Peut-être même pas : « je pense que mon frère et le cauchemar de mon frère sont une seule chose » dira à un moment la jeune fille. Entre imaginaire et réel Pièce à substance, à procédé éclaté, à climats. Récit inquiet qui oscille entre l’ici et l’ailleurs, et qui se plaît à mélanger, à éparpiller les mots entre l’imaginaire et le réel. Manière de « ramener la guerre à la maison… sur nos territoires », comme le souligne Gilles Granouillet, manière aussi de dire en surfil que toutes les mères et toutes les sœurs sont à la fois ici et là-bas, vivant semblables peurs et semblables blessures, peut-être en même temps, en synchronie absolue. Ces zigzags à rythme aléatoire montrent aussi comment celui qui parle est rarement celui qui écoute, car s’il s’agit bien du même personnage, il ne s’agit pas forcément du même état du personnage. On le sait, dans la vie, cela est aussi le cas : l’enfant parle en nous et est écouté par l’adulte en nous, et ces transactions insues et invoulues posent parfois de vrais problèmes, car elles relèvent spectaculairement que chacun voit et parle à l’autre au travers de son propre aveuglement. « J’ai besoin que mes personnages aient mal quelque part… il leur faut un manque pour qu’ils parlent, à chaque réplique… Quand tout est bien, le silence suffit… » énonce l’auteur. C’est précisément ce manque qui les fera exister. A noter enfin pour les lecteurs-spectateurs que le texte, à la demande de Philippe Sireuil, a été repris, retravaillé par Granouillet, et que le rôle de la mère sera interprété…par un acteur ! Ainsi la boucle est bouclée : femme, homme, je est donc bien cet autre qui est moi.
Né à Saint-Etienne, en France, Gilles Granouillet exerce plusieurs métiers avant de s’adonner au théâtre dès la fin des années 80. Tout d’abord metteur en scène, il est actuellement l’auteur d’une dizaine de pièces, dont Le Poids des arbres, Les Anges de Massilia, Vodou, Nos Ecrans bleutés, Six Hommes grimpent sur la colline, L’Envolée… Son œuvre aborde les maux du siècle : le sida, la pauvreté, la guerre… dans une réalité jamais crue, toujours transfigurée par la beauté de la langue. Philippe Sireuil est l’un des grands noms du théâtre belge, à qui l’on doit notamment la création de quasi toute l’œuvre de Jean-Marie Piemme, qu’il accompagne depuis une vingtaine d’années. Dernièrement, du même auteur, il réalise Dialogues d’un chien avec son maître, qui connaît un succès retentissant dans toute la francophonie. Au Poche, il signe les mises en scène de deux spectacles puissants : Les Guerriers de Philippe Minyana en 2002 et Les Mots savent pas dir PHILIPPE SIREUIL, UN ARTISTE SUR LE QUI-VIVE Alternatives théâtrales 108 - Philippe Sireuil, Les coulisses d’un doute, Christine Laure Hirsig, 1er trimestre 2011
Qui-vive… une sonorité tranchante pour un mot affûté, « prêt à bondir », comme Philippe Sireuil. Car, sous le port altier et le verbe élégant de l’homme de théâtre, on soupçonne l’intranquillité, cette compagne fatale des esprits affamés.
Les désirs en crue ne laissent guère de répit à cet homme qui marche… penché en avant, les yeux plissés. Fin comme une lame, son regard s’aiguise au contact de la pensée et au fil de la parole.
L’inclinaison des êtres filiformes de Giacometti n’est qu’à un battement de cils de la douce inclination de Sireuil pour l’inexploré.
L’artiste ne marche pas seul, mais se laisse guider par les puissantes lumières des précédents. À ses côtés, des contemporains défrichent, avec lui. Devant lui, s’étale une ombre paradoxale, la sienne, portée au-delà de lui. C’est vers elle qu’il s’incline, perd l’équilibre, c’est elle qu’il suit inlassablement, et dont il scrute la silhouette ambiguë ; un imaginaire abyssal tout entier ouvert à ses pieds, comme un infini champ de possibles, une sphinge nébuleuse, qui sans cesse questionne. L’enfer du visionnaire, la mine de l’artiste…
Aux anciens, comme aux contemporains, Sireuil répond sur un plateau, mais il ne passe des pages aux planches et ne donne la voix aux mots que quand il se sent en phase avec les œuvres. On ne remonte pas LE ROI LEAR, les tragédies de racine ou la poésie durassienne à n’importe quel âge. On ne percute la portée véritable des textes que dans le dialogue intime qu’ils instaurent avec notre propre vie. Rester sur le qui-vive, c’est se tenir prêt à bondir sur les textes, les empoigner et leur répondre au moment propice.
Sireuil part à la rencontre de chaque texte qu’il met en scène. Pour chacun, il fait le vide puis élabore un nouvel écrin scénique. Sireuil résiste au style.
Dans son univers mutant, on repère pourtant certaines obsessions ; l’omnipotence de la lumière, qu’il signe au même titre que la mise en scène. Obsédante lumière qui va marquer jusqu’aux noms des compagnies qu’il dirige Crépuscule, La Servante… La lumière-couleur habille le plateau, guide l’esprit de l’acteur et donne au jeu sa tonalité singulière.
J’ai rencontré le travail de Philippe Sireuil en clair-obscur il y a six ans. Mon ami et complice de salles obscures, Cédric Dorier m’emmenait voir LES MOTS SAVENT PAS DIRE. Nous sommes entrés en badinant dans le Théâtre de Poche et ressortis sans voix. Brillamment porté par un quatuor d’acteurs romands, le texte de Pascal Rebetez a sonné particulièrement sombre, onirique et brut ce soir-là. Quelques jours et lunes plus tard, j’entrais avec réserve dans LA FORÊT bariolée d’Ostrovski. La saison suivante, je m’abandonnais au trouble de BÉRÉNICE, créée au bien-nommé Théâtre de la Place des Martyrs. C’était un samedi soir en Belgique, je faisais partie d’une délégation du Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, coproducteur de la pièce. Dès le lendemain, nous entrions dans l’espace monochrome du MISANTHROPE, évidemment bleu. Quelques mois plus tard, le duo de LA MUSICA DEUXIÈME portrait avec une sensualité mélancolique, la violence sourde des regrets amoureux. PLEUREZ MES YEUX, PLEUREZ, l’adaptation par le metteur en scène du CID de Corneille, au titre aussi remuant que la tragédie fut monumentale sur le plateau, je pense notamment à la tension de la relation père/fils, entre Don Diègue et Don Rodrigue. L’obstacle amoureux, l’héroïsme, le renoncement, la solitude existentielle, la faille, la tentation de la violence ou de la folie, le courage sont autant de manifestations humaines que le metteur en scène décline avec une fraîcheur renouvelée.
Parce qu’il ne cède pas au bégaiement esthétique, Sireuil a le « qui vive » contagieux. Son œuvre rend alerte, dans la salle comme sur la scène. SUBJECTIVITÉ Alternatives théâtrales 108 - Philippe Sireuil, Les coulisses d’un doute, Philippe Sireuil, 1er trimestre 2011
Mettre en scène, c’est d’abord un acte de lecture, puis à sa suite, un acte d’écriture. Au texte lu, s’ajoute l’écriture scénique qui vient contredire, amplifier, dialectiser, mettre en perspective l’écriture textuelle. Je ne peux commettre ce double geste qu’au travers de textes qui me parlent, m’interrogent, me provoquent, m’émeuvent, me happent, et dont la dimension, à mes yeux, est telle que je suis a priori perdu devant les horizons ou les profondeurs qu’ils recèlent. Sans quoi je reproduis, je recycle, le savoir-faire peut être au rendez-vous, mais l’ennui guette, ce qui ne donne jamais de bons résultats.
Entre le texte et moi, il faut qu’il y ait un chemin à parcourir, un obstacle à surmonter, un vertige à vaincre. Je compare très souvent le métier, celui du metteur en scène comme celui de l’acteur, au travail de l’archéologue : pour trouver quelque chose, il doit creuser la terre, mettre ses mains dans la boue ou dans le sable, prendre des risques, chercher, repérer, tâtonner, gratter, mesurer, creuser, être patient et acharné. Il en va du texte, de ses méandres et ses secrets, comme de la terre et des gravats, il faut fouiller jusqu’à l’excès pour y découvrir ce que l’on cherche confusément, et tant pis pour les écorchures.
Si une pièce s’offre à moi dans l’immédiateté d’une première fois, si sa lecture ne m’occasionne ni effort, ni inconfort, si, à l’instant où je referme le livre, je sais comment je pourrais aller au bout d’elle-même avec les acteurs, je n’en entreprends pas le détour. Á chaque fois, j’ai besoin de cette exaltation, de cet égarement – qui ne sont pas que fantasmatiques - :le texte est une montagne à gravir, bien souvent le matériel d’escalade n’est pas des plus appropriés, mais si on arrive à gagner le sommet, on peut espérer savourer et faire savourer le paysage ainsi dévoilé.
« Est contemporain ce qui me parle encore », la citation est de Laurent Busine, directeur du Musée des Arts Contemporains du Grand Hornu. Je ne peux mieux dire. La contemporanéité, ce n’est pas un label, c’est une adéquation, dans un temps donné, de l’objet regardé et de qui le regarde. Nombre de textes d’aujourd’hui ne me disent rien alors que d’autres d’hier me parlent beaucoup. Passé mes débuts où je pêchais par timidité et ignorance, j’ai toujours chercher à alterner entre passé et présent, répertoire et découverte.
L’acteur, contrairement à ce que l’on a pu croire, a toujours été au centre de mes préoccupations, et si, dans un premier temps, on m’a catalogué comme privilégiant l’image scénique au jeu dramatique, c’est plus en raison de mes peurs et de mes incapacités face à l’acteur que de mon appétit à déployer mon imaginaire scénique. Le jour où j’ai accepté de dire tout haut et devant toute la distribution que je ne savais pas comment répondre à la question qui m’était posée, j’avais fait un grand pas en avant.
Ce sont des acteurs, des aînés qui m’ont appris le métier, et tout particulièrement deux d’entre eux, Janine Godinas et Christian Maillet. On n’insistera jamais assez dans notre métier sur l’importance de la transmission, beaucoup de jeunes confrères semblent vivre le théâtre entre eux, et je le déplore, ils ne savent pas ce qu’ils perdent à prolonger leur adolescence théâtrale, à ne pas aller à la rencontre des acteurs de temps, de lieu ou de « famille » différents des leurs.
Enseigner m’a souvent donné, sur les textes abordés au cours d’ateliers de jeu, une légèreté qu’au théâtre je n’arrivais pas à saisir. L’école donne souvent de la liberté alors que, parfois, le théâtre fige. Les conditions du laboratoire, la composition du groupe, l’absence totale de pression socioprofessionnelle, la pauvreté des moyens nous forcent de recourir à des solutions auxquelles on rechignerait au théâtre. Je me souviens par exemple d’un travail fait à l’Insas sur Dans la solitudes des champs de coton de Bernard-Marie Koltès : une quinzaine de garçons et de filles s’était partagé les rôles du client et du dealer, ils étaient assis dans de vieux fauteuils de cinéma alignés par rangée ; garçon – fille, garçon – garçon, fille – fille, fille –garçon, le texte filait de l’un à l’autre, comme dans une course de relais ; nous avions pris une totale liberté, savoureusement iconoclaste pour ce qui est du traitement des deux rôles, mais, paradoxalement, comme les enjeux de l’écriture étaient à chaque fois rebattus et débattus au travers de la pluralité de leurs personnalités, j’ai eu le sentiment de mieux mettre en scène les virtualités multiples du désir et deal koltésiens que dans la mise en scène que j’ai faite du même texte au théâtre.
Dans le métier du théâtre, on est très vite prisonnier : des moyens de production, du regard des autres, de sa pensée comme de ses propres tics, d’un style qui s’invente à travers le savoir-faire, la pathologie personnelle, les goûts, les manières de traiter l’image au plateau. Il faut accepter de trouver les moyens – ce n’est pas le plus facile – de se mettre en cause, en déséquilibre, jusqu’au péril. Chaque metteur en scène a sa pathologie, sa syntaxe et sa grammaire, et je n’échappe pas à la règle. « Le théâtre est un acte de résistance », écrivait Antoine Vitez ; j’ajouterais : un acte de résistance à soi-même. |
LA MAMAN DU PETIT SOLDAT |