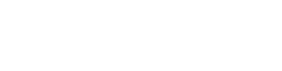|
LHISTOIRE DUN MALENTENDU
entretien avec Gérard Desarthe réalisé par Julien Lambert, deux semaines avant la Première au Théâtre de Vidy.
Gérard Desarthe, avec cette pièce qui touche à la pédophilie, vous vous attaquez à un sujet épineux, sur lequel il est même devenu risqué de s’exprimer, dans notre société... C’est le devoir de la dramaturgie contemporaine de traiter des sujets qui font débattre. Je suis curieux des réactions du public, en espérant qu’il fera la distinction entre la pédophilie en tant que déviance de nature psychiatrique, et le cas de ce personnage qui a eu une aventure amoureuse et sexuelle avec une jeune fille de douze ans, et qui a été condamné pour abus sexuel. Ray s’est reconnu pédophile pour obtenir une remise de peine, parce qu’en prison on l’a catalogué comme pédophile, et forcé à adopter ce diagnostic.
L’enjeu de la pièce, qui oppose les deux personnages et leurs souvenirs respectifs quinze ans après, est donc de réviser le jugement de la société, plus que de découvrir ce qui s’est passé... L’intérêt de la pièce réside dans la démarche du souvenir autant que dans les faits qui s’y racontent. C’est l’histoire d’un malentendu. Harrower ne prend pas parti et je n’ai pas de morale à faire non plus, mais pour moi Ray est un innocent : il a subi les événements sans être conscient de leurs conséquences, ni savoir les contrôler. On aimerait lui dire : « mais tu n’as pas pu réfléchir avant d’embarquer cette gamine ? » Parlant des pédophiles, il dit : « je ne suis pas comme ça ».
Ne soupçonnez-vous pas qu’il puisse cacher son jeu ? Je ne peux me battre que sur ce que dit le personnage dans le texte : il faut le croire. Dans ses pièces, Harrower ne parle d’ailleurs que de gens simples, pas d’esprits capables d’un double discours. Ray n’est pas PDG, mais manutentionnaire dans une banlieue minable ; il dit des choses dont il ne soupçonne pas l’énormité.
Pour Raoul Teuscher, qui a joué avec vous un Néron noir et clownesque, le petit bonhomme que vous décrivez se présente comme un contre-emploi... J’aimerais l’amener sur ce terrain, oui, pour l’inciter au changement et à montrer sa palette. Souvent les acteurs d’expérience n’osent pas bouger, ils cherchent trop l’efficacité. Pour Prune Beuchat c’est plus facile, sa palette est naturellement ouverte. C’est aussi dû au rôle : son personnage ne cherche qu’à comprendre ; c’est Ray qui a du mal à dire les choses, qui voit parler en lui des mots étrangers. Son rôle à elle est moins polyphonique, mais c’est si beau, cette quête...
Cette résistance de Ray dans la parole est aussi celle du spectateur qui suit son chemin pas à pas, chaque mot lâché pesant lourd... d’un autre côté, la langue ici est le lieu-même de la fiction, la seule vérité tangible... C’est une écriture terriblement bien ficelée, bizarre, trouble, pleine de sous-textes et de non-dits... le bégayement de Ray est-il réel ou est-ce son esprit qui bégaye ?
Le texte alterne dialogues fragmentés et monologues aux accents parfois plus lyriques ou sentimentaux, instantanés de vie et réminiscences du passé : quel type de jeu cela implique-t-il ? Cela demande des changements abrupts d’attitude, des ruptures, mais aussi un découpage de l’action en séquences, en flash mentaux évoqués par des changements brusques de lumière et d’atmosphère. Le décor évite d’ailleurs tout réalisme, pour créer un huis-clos dans la tête des personnages.
Votre parcours d’acteur impressionnant vous pousse-t-il à être un metteur en scène interventionniste? Je suis acteur et j’interviens comme un acteur. Je me permets de travailler presque comme Strehler, qui disait carrément: « fais comme moi ! ». Je ne peux guider les acteurs qu’en les faisant passer par ce que j’ai joué et ressenti moi-même. C’est déroutant, cela demande une grande complicité, mais la plupart du temps, les comédiens me suivent.
Ce n’est pas vraiment la tendance actuelle... Le plus intéressant au théâtre, c’est l’acteur ; le mettre dans un cocon entouré de professionnels, et le faire travailler. J’ai vu tant de metteurs en scène qui parlent très bien du sujet de la pièce, mais moins des situations, de la langue, de ces choses qui nourissent l’acteur : parachuté sur scène, un comédien ne sait d’abord pas quoi faire ; il est catastrophique de les laisser se débrouiller. Beaucoup sortent des écoles insuffisamment préparés au travail concret du plateau ; ils ont fait des choses, mais tellement morcelées... en un mois et demi de stage sur Brecht, puis sur Shakespeare, qu’est-ce qu’on peut faire ? À CHAQUE PIÈCE SON LANGAGE Propos de David Harrower
|
BLACKBIRD |